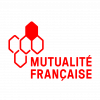Organisations
L’idéologie néfaste des start-ups
Le livre de Mathilde Ramadier, Bienvenue dans le nouveau monde. Comment j’ai survécu à la « coolitude » des start-ups, décrit avec un humour sans pitié l’univers glaçant de ces jeunes pousses du capitalisme. Expérience vécue d’une jeune femme qui souhaiterait que les syndicats puissent mettre leur nez dans cet univers. Elle s'en est entretenue avec Évelyne Salamero, journaliste à FO Hebdo.
Ces start-ups que vous décrivez disent révolutionner le monde. Qu’en est-il ?
Une minorité de start-ups font des choses réellement innovantes. Mais quand une énième boîte propose un service de VTC ou de livraison de repas à domicile, je me demande en quoi cela révolutionne le monde. D’ailleurs, 90 % des start-ups échouent.
Les start-ups se vantent aussi de rendre le monde du travail meilleur.
J’ai constaté exactement l’inverse pendant quatre ans, à travers une bonne douzaine d’expériences. Le monde des start-ups reproduit ni plus ni moins que l’ancien monde de l’entreprise, avec des rapports de domination et de subordination, des employés jetables, des contrats précaires, sauf qu’on revêt tout cela d’un habit neuf, beaucoup plus sexy et que les réseaux sociaux et internet ne montrent que cet habillage.
C’est ce que vous appelez la « coolitude » ?
Oui, tout est fait pour rendre ce monde du travail ludique, agréable et amical. On nous livre des corbeilles de fruits, des viennoiseries, on nous met des friandises dans tous les coins, le réfrigérateur est toujours rempli de jus de fruit, on organise des apéritifs, des sorties, on fête les anniversaires… Mais tout cela masque une certaine perversité. L’objectif est que la frontière entre vie privée et professionnelle s’efface et que, finalement, on se retrouve à faire des heures sup sans s’en rendre compte. Complètement asservi, ayant totalement absorbé le discours de l’entreprise, on finit comme une sorte d’homme sandwich permanent de l’entreprise. J’ai récemment entendu deux jeunes « start-upeurs » de 22 ans expliquer à une assemblée d’étudiants comment tirer le meilleur de stagiaires non payés, comment les amener à faire de la pub pour votre boîte même pendant le week-end.
Vous accusez ces start-ups de diffuser une idéologie néfaste. Pouvez-vous préciser ?
C’est la rhétorique du winner [gagnant, NDLR] dans la jungle. J’ai particulièrement observé cela à Paris car, même si je n’y ai pas travaillé, j’y ai beaucoup enquêté, recueilli des témoignages et analysé les offres d’emplois. On nous fait croire qu’aujourd’hui tout le monde peut monter sa boîte et que les diplômes comptent moins. Mais quand on regarde les jeunes PDG de start-ups, ce sont en grande majorité des hommes blancs, les noms à particule n'étant pas rares et on retrouve le même profil « école de commerce ». Après la parution du livre, un entrepreneur a écrit : Madame Ramadier, vous n’avez pas compris quelque chose d’essentiel, c’est que les start-ups sont le nouvel ascenseur social et que c’est darwiniste. En clair, seuls les plus forts survivent. Quant à l’ascenseur social, il laisse dans la majorité des cas à désirer.
Vous dites avoir « survécu » à la « coolitude » des start-ups. Le mot est fort.
Oui, je me considère vraiment comme une survivante parce que j’ai connu des gens qui sont tombés en dépression, pendant mes quatre années à Berlin. Certains ont dû rentrer chez leurs parents parce qu’ils allaient très mal et qu’en plus ils n’arrivaient pas à gagner assez pour être indépendants. Depuis la parution de mon livre en février dernier, j’ai reçu une centaine de messages. J’ai été extrêmement sollicitée et pas seulement par vos confrères. Beaucoup de lecteurs se sont reconnus dans mon propos et m’ont dit que cela leur a permis de comprendre qu’ils n’étaient pas seuls, ni nuls. Personnellement, j’ai survécu surtout parce que ma vie n’en dépendait pas, c’était pour moi un complément de revenu. J’ai publié mes premiers livres en 2012. J’ai commencé par la bande dessinée. J’évoluais dans un monde d’artistes et l’humour n’était jamais loin. Le soutien de mes proches a aussi été déterminant. Le soir, je leur racontais ce qu'il s’était passé dans la journée et nous en riions beaucoup. Mais il y a tout de même eu des jours plus supportables que d’autres.
L’humour est effectivement très présent dans votre livre. Vous décrivez des scènes de manière très imagée, qui du coup en deviennent hilarantes, malgré leur gravité. Parfois, au contraire, vous utilisez un champ lexical qui évoque l’univers des régimes totalitaires. On se croirait aussi un peu dans Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley, parfois on pense à une secte… Pourtant, on quitte une start-up quant on veut… N’avez-vous pas forcé le trait ?
Rien de ce que je décris n’est exagéré, ni caricaturé. Cela s’est passé exactement comme je le raconte. Tout est absolument véridique. Quant à quitter une start-up comme on veut, quand on veut, ce n’est pas si sûr. Récemment, j’ai reçu le message d’une jeune femme qui ne va pas très bien, qui est dans une start-up où ça se passe mal et qui m’écrit pour me demander comment elle peut faire pour se sortir de là sans se griller dans tout le milieu. C’est un petit milieu. Quand on démissionne trop vite, de façon répétée, quand on se fait renvoyer, ça se sait assez vite. Les entrepreneurs forment une sorte de club. Il n’est pas si sûr que l’on puisse quitter une start-up aussi facilement, surtout quand on ne fait rien d’autre, qu’on ne connaît rien d’autre, que l’on a été formé pour évoluer dans ce milieu. Ce n’était pas mon cas. Mais je me mets à la place de ceux qui ont fait des études qui mènent à ça et/ou qui sont exclusivement là-dedans, c’est très compliqué d’en sortir.
Comment expliquez-vous que l’on puisse se laisser piéger à ce point ?
Beaucoup sont encore très jeunes, manquent de maturité, sont encore un peu naïfs et, surtout, n’ont qu’une peur : se retrouver à Pôle Emploi. Il y a aussi une part de servitude volontaire car ils manquent d’expérience, de confiance en eux et ont un grand besoin de reconnaissance. Ils vont alors se laisser asservir par un dirigeant, sans arriver à trouver la force de hausser le ton, parce qu’ils sont pris dans un modèle dominant, qui en plus intègre tous les domaines de leur vie. Au bout d’un moment, cette emprise ne concerne plus seulement le travail mais tout leur style de vie. Quand on commence à critiquer la boîte dans laquelle on travaille, on remet tout en question, on remet en question son cercle d’amis, ses collègues, sa propre façon de vivre et donc soi-même et sa propre existence. C’est aussi ce que l’on voit avec l’engouement actuel autour de l’élection d'Emmanuel Macron : une espèce de rêve collectif basé en réalité sur une réussite individuelle et un modèle très libéral. La Californie, la Silicon Valley, c’est séduisant comme référence. Toutes ces valeurs-là font rêver au premier abord, surtout quand on n’a pas encore une conscience politique très affirmée.
Quels conseils donneriez-vous à ceux qui arrivent dans une start-up ?
Il ne faut surtout pas délaisser son esprit critique, il faut garder de la hauteur et ne pas se laisser embarquer contre son gré. Si quelque chose vous paraît ridicule ou infondé, il ne faut pas hésiter à le dire. Puisque les start-ups invitent à prendre des initiatives et à être créatifs, il faut les prendre au mot, que ça marche aussi dans le sens de la critique. Ce n’est pas facile mais il faut s’efforcer de s’exprimer. J’ai toujours dit pourquoi je démissionnais, à la DRH en particulier, en envoyant un e-mail collectif à toute l’équipe. Quand je n’étais pas d’accord, même si je ne disais rien verbalement sur le moment, cela se voyait tout de suite sur mon visage, je ne cherchais pas à dissimuler. De toutes les façons, on travaille en open-space, on ne peut pas se cacher. La moindre émotion et la moindre action sont visibles. Autant s’en servir.
Est-il possible de créer un syndicat ou un comité d’entreprise dans une start-up ?
Cela semble tout à fait impossible. Je n’en ai jamais vu dans aucune de celles où j’ai travaillé. Pourtant, certaines avaient déjà 150 salariés. C’est l'une des choses que je souhaiterais, que les syndicats se préoccupent de cette question. On voit en France des syndicats se créer pour les chauffeurs VTC. Il faudrait faire la même chose pour tous les corps de métiers, les livreurs et toutes les petites mains.
Ces start-ups que vous décrivez disent révolutionner le monde. Qu’en est-il ?
Une minorité de start-ups font des choses réellement innovantes. Mais quand une énième boîte propose un service de VTC ou de livraison de repas à domicile, je me demande en quoi cela révolutionne le monde. D’ailleurs, 90 % des start-ups échouent.
Les start-ups se vantent aussi de rendre le monde du travail meilleur.
J’ai constaté exactement l’inverse pendant quatre ans, à travers une bonne douzaine d’expériences. Le monde des start-ups reproduit ni plus ni moins que l’ancien monde de l’entreprise, avec des rapports de domination et de subordination, des employés jetables, des contrats précaires, sauf qu’on revêt tout cela d’un habit neuf, beaucoup plus sexy et que les réseaux sociaux et internet ne montrent que cet habillage.
C’est ce que vous appelez la « coolitude » ?
Oui, tout est fait pour rendre ce monde du travail ludique, agréable et amical. On nous livre des corbeilles de fruits, des viennoiseries, on nous met des friandises dans tous les coins, le réfrigérateur est toujours rempli de jus de fruit, on organise des apéritifs, des sorties, on fête les anniversaires… Mais tout cela masque une certaine perversité. L’objectif est que la frontière entre vie privée et professionnelle s’efface et que, finalement, on se retrouve à faire des heures sup sans s’en rendre compte. Complètement asservi, ayant totalement absorbé le discours de l’entreprise, on finit comme une sorte d’homme sandwich permanent de l’entreprise. J’ai récemment entendu deux jeunes « start-upeurs » de 22 ans expliquer à une assemblée d’étudiants comment tirer le meilleur de stagiaires non payés, comment les amener à faire de la pub pour votre boîte même pendant le week-end.
Vous accusez ces start-ups de diffuser une idéologie néfaste. Pouvez-vous préciser ?
C’est la rhétorique du winner [gagnant, NDLR] dans la jungle. J’ai particulièrement observé cela à Paris car, même si je n’y ai pas travaillé, j’y ai beaucoup enquêté, recueilli des témoignages et analysé les offres d’emplois. On nous fait croire qu’aujourd’hui tout le monde peut monter sa boîte et que les diplômes comptent moins. Mais quand on regarde les jeunes PDG de start-ups, ce sont en grande majorité des hommes blancs, les noms à particule n'étant pas rares et on retrouve le même profil « école de commerce ». Après la parution du livre, un entrepreneur a écrit : Madame Ramadier, vous n’avez pas compris quelque chose d’essentiel, c’est que les start-ups sont le nouvel ascenseur social et que c’est darwiniste. En clair, seuls les plus forts survivent. Quant à l’ascenseur social, il laisse dans la majorité des cas à désirer.
Vous dites avoir « survécu » à la « coolitude » des start-ups. Le mot est fort.
Oui, je me considère vraiment comme une survivante parce que j’ai connu des gens qui sont tombés en dépression, pendant mes quatre années à Berlin. Certains ont dû rentrer chez leurs parents parce qu’ils allaient très mal et qu’en plus ils n’arrivaient pas à gagner assez pour être indépendants. Depuis la parution de mon livre en février dernier, j’ai reçu une centaine de messages. J’ai été extrêmement sollicitée et pas seulement par vos confrères. Beaucoup de lecteurs se sont reconnus dans mon propos et m’ont dit que cela leur a permis de comprendre qu’ils n’étaient pas seuls, ni nuls. Personnellement, j’ai survécu surtout parce que ma vie n’en dépendait pas, c’était pour moi un complément de revenu. J’ai publié mes premiers livres en 2012. J’ai commencé par la bande dessinée. J’évoluais dans un monde d’artistes et l’humour n’était jamais loin. Le soutien de mes proches a aussi été déterminant. Le soir, je leur racontais ce qu'il s’était passé dans la journée et nous en riions beaucoup. Mais il y a tout de même eu des jours plus supportables que d’autres.
L’humour est effectivement très présent dans votre livre. Vous décrivez des scènes de manière très imagée, qui du coup en deviennent hilarantes, malgré leur gravité. Parfois, au contraire, vous utilisez un champ lexical qui évoque l’univers des régimes totalitaires. On se croirait aussi un peu dans Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley, parfois on pense à une secte… Pourtant, on quitte une start-up quant on veut… N’avez-vous pas forcé le trait ?
Rien de ce que je décris n’est exagéré, ni caricaturé. Cela s’est passé exactement comme je le raconte. Tout est absolument véridique. Quant à quitter une start-up comme on veut, quand on veut, ce n’est pas si sûr. Récemment, j’ai reçu le message d’une jeune femme qui ne va pas très bien, qui est dans une start-up où ça se passe mal et qui m’écrit pour me demander comment elle peut faire pour se sortir de là sans se griller dans tout le milieu. C’est un petit milieu. Quand on démissionne trop vite, de façon répétée, quand on se fait renvoyer, ça se sait assez vite. Les entrepreneurs forment une sorte de club. Il n’est pas si sûr que l’on puisse quitter une start-up aussi facilement, surtout quand on ne fait rien d’autre, qu’on ne connaît rien d’autre, que l’on a été formé pour évoluer dans ce milieu. Ce n’était pas mon cas. Mais je me mets à la place de ceux qui ont fait des études qui mènent à ça et/ou qui sont exclusivement là-dedans, c’est très compliqué d’en sortir.
Comment expliquez-vous que l’on puisse se laisser piéger à ce point ?
Beaucoup sont encore très jeunes, manquent de maturité, sont encore un peu naïfs et, surtout, n’ont qu’une peur : se retrouver à Pôle Emploi. Il y a aussi une part de servitude volontaire car ils manquent d’expérience, de confiance en eux et ont un grand besoin de reconnaissance. Ils vont alors se laisser asservir par un dirigeant, sans arriver à trouver la force de hausser le ton, parce qu’ils sont pris dans un modèle dominant, qui en plus intègre tous les domaines de leur vie. Au bout d’un moment, cette emprise ne concerne plus seulement le travail mais tout leur style de vie. Quand on commence à critiquer la boîte dans laquelle on travaille, on remet tout en question, on remet en question son cercle d’amis, ses collègues, sa propre façon de vivre et donc soi-même et sa propre existence. C’est aussi ce que l’on voit avec l’engouement actuel autour de l’élection d'Emmanuel Macron : une espèce de rêve collectif basé en réalité sur une réussite individuelle et un modèle très libéral. La Californie, la Silicon Valley, c’est séduisant comme référence. Toutes ces valeurs-là font rêver au premier abord, surtout quand on n’a pas encore une conscience politique très affirmée.
Quels conseils donneriez-vous à ceux qui arrivent dans une start-up ?
Il ne faut surtout pas délaisser son esprit critique, il faut garder de la hauteur et ne pas se laisser embarquer contre son gré. Si quelque chose vous paraît ridicule ou infondé, il ne faut pas hésiter à le dire. Puisque les start-ups invitent à prendre des initiatives et à être créatifs, il faut les prendre au mot, que ça marche aussi dans le sens de la critique. Ce n’est pas facile mais il faut s’efforcer de s’exprimer. J’ai toujours dit pourquoi je démissionnais, à la DRH en particulier, en envoyant un e-mail collectif à toute l’équipe. Quand je n’étais pas d’accord, même si je ne disais rien verbalement sur le moment, cela se voyait tout de suite sur mon visage, je ne cherchais pas à dissimuler. De toutes les façons, on travaille en open-space, on ne peut pas se cacher. La moindre émotion et la moindre action sont visibles. Autant s’en servir.
Est-il possible de créer un syndicat ou un comité d’entreprise dans une start-up ?
Cela semble tout à fait impossible. Je n’en ai jamais vu dans aucune de celles où j’ai travaillé. Pourtant, certaines avaient déjà 150 salariés. C’est l'une des choses que je souhaiterais, que les syndicats se préoccupent de cette question. On voit en France des syndicats se créer pour les chauffeurs VTC. Il faudrait faire la même chose pour tous les corps de métiers, les livreurs et toutes les petites mains.
Pas encore de commentaires