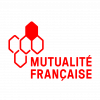Organisations
Alerte sur les délais de consultation du CE : une ordonnance pour éviter le déni de justice
Pour mémoire, les nouvelles dispositions issues de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 prévoient désormais que :
- sauf accord collectif sur le sujet où, « en l’absence de délégué syndical », accord conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise « adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité », le délai du comité d’entreprise pour rendre un avis est (L. 2323-3-3 et R. 2323-1-1) :
- d’un mois en l’absence d’intervention d’un expert ;
- deux mois en cas d’intervention d’un expert ;
- trois mois en cas de saisine du CHSCT (et quatre mois s’il y a saisine d’une IC-CHSCT par l’employeur) ;
- ce délai court à compter du jour où l’employeur a transmis les informations aux représentants du personnel (R. 2323-1) ;
- à l’expiration de ce délai, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif s’il n’a pas encore rendu d’avis formel (L. 2323-3)
Depuis la loi du 17 août 2015, il en va de même pour le CHSCT et l’IC-CHSCT (en cas de saisine) qui sont également réputés, en l’absence d’avis, avoir été consultés et rendus un avis négatif à l’expiration d’un délai expirant au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai imparti au CE pour rendre son avis.
Il s’agit d’un délai « automatique ». Même si l’information est notoirement déficiente, le CE, une fois passé ce délai, ne peut plus s’opposer à la mise en œuvre de la réorganisation.
En cas d’information insuffisante, la seule possibilité pour le CE est de saisir en référé le président du Tribunal de Grande Instance « statuant en la forme des référés », comme prévu par l’article L. 2323-4 alinéas 2 & 3, également issu de la loi de sécurisation de l’emploi, afin que le juge « ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants » et/ou qu’il décide la prolongation du délai « en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise ».
L’article L. 2323-4 précise par ailleurs que « le juge statue dans un délai de 8 jours » et par ailleurs et surtout que la saisine du juge « n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis ».
Délai irréaliste imparti au juge
La difficulté concrète de ces nouvelles dispositions est qu’en pratique, dans nombre de juridictions, et en tout cas à Paris et en région parisienne, le délai de 8 jours imparti au juge pour rendre sa décision à compter de sa saisine est complètement irréaliste.
Ainsi, dans l’un des deux arrêts rendus le 21 septembre 2016 par la Cour de cassation, la saisine devant le juge de Nanterre avait été faite le 21 mai 2014 et l’ordonnance rendue le 9 juillet suivant. En général, dans la région parisienne du moins, il faut le plus souvent compter 2 à 3 mois pour obtenir une décision.
Si l’on ajoute à cela le fait que le délai court à compter de la date de la remise des informations, et non à compter de la première réunion du CE au cours de laquelle un mandat peut seulement à ce moment-là être voté, le délai restant (surtout si l’on est sur une consultation n’impliquant pas l’intervention du CHSCT) est extrêmement court.
Il est toujours possible, pour retarder les délais, de désigner un expert libre, comme le prévoient l’article R. 2323-1-1 et la circulaire DGT 2014/1 du 18 mars 2014. Il reste que les délais courent très rapidement, surtout si le processus de consultation est initié au début du mois de juillet ou mi-décembre, selon une pratique pénible qui a tendance à devenir de plus en plus fréquente…
Stricte application des textes
L’application stricte des textes risque donc d’aboutir à une situation où le comité d’entreprise, même s’il est particulièrement diligent, n’est concrètement pas en mesure de pouvoir obtenir une décision avant l’expiration des délais, situation de nature à caractériser un déni de justice.
La question s’était donc posée de savoir s’il ne convenait pas de retenir une interprétation souple des textes applicables en considérant que le juge pouvait ordonner la suspension de la procédure d’information/consultation dès lors qu’il avait été saisi dans les délais impartis par les articles L. 2323-3-3 et R. 2323-1-1 mentionnés ci-dessus.
- C’est cette position qu’avait retenue la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt rendu le 16 décembre 2014 et qui a été censurée par la Cour de cassation dans un premier arrêt « GDF » rendu le 21 septembre 2012 (P n° 15-13363).
Pour la Haute Cour, dès lors que les délais sont expirés au moment où le premier juge statue, il ne peut tout simplement plus statuer sur les demandes de suspension car l’avis est censé avoir déjà été rendu.
Peu importe que le processus d’information ait été particulièrement déficient et déloyal, si les délais sont dépassés au moment où le premier juge statue, il est trop tard.
D’aucuns diront qu’il s’agit là d’un nouvel arrêt pro-employeur de la Cour de cassation mais à tort : dans cet arrêt, la Cour de cassation n’a fait qu’appliquer les textes très clairs résultant de la loi de sécurisation de l’emploi. Elle ne pouvait prendre une position différente, sauf à rendre une jurisprudence contra legem, c’est-à-dire en contradiction totale avec la loi. Cela lui est tout simplement interdit, conformément au principe de séparation des pouvoirs qui est au cœur de notre démocratie.
La prorogation des délais d’un commun accord entre le CE et l’employeur doit nécessairement faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité au CE.
Dans le second arrêt « BDAF » du 21 septembre 2016 (P n° 15-19003), la Cour de cassation, procédant là encore à une lecture stricte des textes applicables, considère d’abord que les délais courent dès lors qu’est remis un document d’informations écrit permettant au CE de « mesurer l’importance de l’opération envisagée ». Peu importe que l’information ne soit pas « complète et loyale », elle peut même être très lacunaire : le CE, s’il souhaite obtenir une prorogation des délais et des informations complémentaires, n’a pour seule option que de saisir le juge des référés à défaut d’accord avec l’employeur (accord collectif ou subsidiairement accord conclu au sein du CE). S’agissant justement de ce dernier point, la Cour de cassation considère qu’une prorogation des délais d’un commun accord avec l’employeur dans le cadre d’un accord conclu avec le Comité d’entreprise doit nécessairement faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres titulaires élus du comité ; l’accord seul de l’employeur ne suffit pas. Là encore, il s’agit d’une interprétation littérale des textes,mais cette fois ci les deux positions prises par la Cour de Cassation, surtout lorsqu’elles sont combinées entre elles, sont plus discutables et ne vont pas sans soulever de nombreuses difficultés.
Par exemple, est-ce qu’une simple annonce d’une fusion à intervenir sans la moindre autre précision va commencer à faire courir les délais, au motif que le simple terme de « fusion » laisserait tout à fait mesurer l’importance de l’opération envisagée ? Quid des projets à étapes, par exemple un déménagement d’un site vers un autre, où plusieurs consultations successives sont envisagées par l’employeur (ex : consultation sur la dénonciation du bail, sur la conclusion d’un nouveau bail, sur l’emménagement des nouveaux locaux) ? Quid de toutes les situations ou les CE (et ils seront nombreux !) seront dupés par les promesses de l’employeur faites d’apporter des éléments complémentaires ultérieurement ou encore de procéder à plusieurs réunions échelonnées sur un délai supérieur aux délais légaux ? Quid si l’employeur convoque tardivement son CE, en envoyant par exemple les informations au début du mois d’août pour le convoquer 3 semaines après alors que la quasi-totalité des représentants du personnel sont en congés ?
Même si l’on peut comprendre que la Cour de Cassation ait souhaité faire preuve en cette matière d’une volonté d’efficacité au regard des objectifs du Législateur, il n’en reste pas moins qu’une telle jurisprudence va indirectement favoriser les comportements déloyaux des employeurs. Cela va aboutir également à une multiplication des contentieux (puisqu’il n’y aura pas d’autre choix que de saisir le Juge, de « tirer » avant de « discuter ») qui vont non seulement entraîner des répercussions sur les moyens financiers des CE mais également et surtout un nouvel afflux considérable de dossiers devant les juridictions qui sont déjà littéralement asphyxiées. La simple menace d’un contentieux permettait par le passé d’avoir un effet réellement contraignant pour l’employeur. Désormais, il faudra absolument et impérativement avoir recours à un avocat dès l’engagement du processus de consultation et ce à la moindre difficulté, ce qui est tout de même un comble pour une loi qui se voulait simplifier les relations juridiques et limiter les contentieux.
Plutôt que de s’en tenir à une interprétation littérale des textes, la Cour de Cassation aurait pu tout d’abord avoir effectivement recours à la notion de loyauté du processus de consultation en rappelant tout d’abord que les délais prévus par l’article L. 2323-3 du Code du travail ont pour objectifs, d’après les termes même de cet article, de permettre au Comité d’entreprise « d'exercer utilement sa compétence ».
Sans aller jusqu’à la notion d’« informations précises et écrites » prévue par l’article 2323-4 al.1 du Code du travail qui est en relation avec la faculté de saisine du Juge, la Cour de Cassation aurait pu considérer que cette notion d’ « exercice utile » de compétence se réfère d’abord et avant tout à la loyauté du processus de consultation. Elle aurait pu considérer en conséquence qu’un tel processus loyal suppose d’abord et avant tout que le Comité d’entreprise dispose d’une information qui non seulement lui permettre de « mesurer l’importance de l’opération envisagée », mais également et d’abord et surtout « ses impacts sur les salariés concernés ».
Ainsi par exemple, s’agissant de l’affaire soumise à l’appréciation de la Cour de Cassation dans cet arrêt du 21 septembre 2016, l’information délivrée au CE, au-delà des « 42 pages » du document d’information, ne comportait aucun aspect sur les conséquences sociales résultant de la fusion, qui d’après la direction allait faire l’objet d’une consultation ultérieure. Or, la mise en œuvre d’un processus de fusion entraîne forcément des impacts sociaux, ne serait-ce qu’en raison de ses impacts nécessaires sur le processus décisionnel, et il existe une jurisprudence abondante sur le sujet (voir par exemple, pour une fusion : CA Paris, 31 juillet 2009, CE Caisse d’Epargne Ile de France, et les commentaires suivant au sein de la revue RJS (2009, n°862) : « Il faut aussi que le comité soit, « dès l'origine », suffisamment informé sur le projet. Dans le cas d'un projet de fusion, le caractère suffisant de l'information suppose que celle-ci comporte une description précise du projet industriel, de la stratégie du nouveau groupe, du business plan et des conséquences sur l'emploi du projet de rapprochement des deux groupes. »). Par ailleurs, le plus souvent, en cas de fusion, le CE de l’entreprise absorbée disparaît et seul le CE de l’entreprise absorbante subsiste, ce qui fait que les salariés de l’entreprise absorbée ne sont plus représentés jusqu’aux prochaines élections. La solution retenue par la Cour de Cassation dans cette affaire soulève donc de sérieuses difficultés quant à la loyauté du processus de consultation qui n’est ainsi pas assurée. Entre la notion d’information complète et exhaustive et celle d’information minimum pouvant permettre d’assurer la mise en œuvre d’un processus de consultation dans des conditions loyales, il y a une différence.
Sur le second volet de ce second arrêt du 21 septembre 2016, la Cour de Cassation aurait pu également juger qu’au-delà de la procédure stricte prévue par l’article L.2323-1 relative à la détermination du délai par voie conventionnelle (accord collectif ou, à défaut de délégué syndical, accord avec le CE avec délibération majoritaire), l’employeur était en tout état de cause lié par ses propres engagements unilatéraux pris vis-à-vis du Comité d’entreprise, et que si par exemple il informait son comité d’entreprise de la mise en œuvre d’un calendrier de consultation supérieur à la durée légale, il était alors tenu par la mise en œuvre d’un tel calendrier (sur la notion d’opposabilité d’un engagement unilatéral à durée déterminée : voir Cass. soc. 4 avril 1990 n° 86-42.626).
Une vision plus souple des dispositions applicables aurait donc pu permettre de sanctionner les comportements déloyaux de l’employeur et d’assurer une certaine souplesse au processus de consultation du Comité d’entreprise tout en évitant une multiplication des contentieux. L’on ne peut donc que regretter la vision stricte de la Cour de Cassation dans ce second arrêt du 21 septembre 2016 qui, sous couvert d’efficacité, pourra être analysée par certains employeurs comme une incitation à la déloyauté, c’est-à-dire au non respect des règles de droit.
Déni de justice
Il reste que c’est bien évidemment le premier arrêt qui pose le plus de difficultés, ou plus précisément, les dispositions de l’article L. 2323-4 alinéa 3 du Code du travail, selon lesquelles la saisine du juge « n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis ». La solution retenue par le législateur et logiquement entérinée par la Cour de cassation, revient en effet à faire peser sur le comité d’entreprise, titulaire d’un droit à une information complète et loyale et d’un droit à consultation, le risque lié à l’engorgement des juridictions susceptible d’aboutir à une situation de déni de justice.
Il convient de rappeler que ce droit à information et à consultation du comité d’entreprise trouve son fondement dans le 8ème alinéa du préambule de 1946, selon lequel : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion de l’entreprise ».
Le mécanisme ainsi mis en place par le législateur est donc susceptible de constituer une double violation des dispositions constitutionnelles : celles de l’article 16 de la Déclaration de 1789 garantissant le droit à un recours juridictionnel effectif et celles du 8ème alinéa du préambule de 1946 garantissant une participation des salariés à la gestion de l’entreprise par l’intermédiaire de leurs représentants.
Un parallèle peut être effectué à cet égard avec la fameuse décision Foot Locker du Conseil constitutionnel du 25 novembre 2015 qui portait sur la question de la prise en charge par l’employeur des honoraires de l’expert CHSCT. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a sanctionné l’ancienne réglementation telle qu’interprétée par la jurisprudence (à tort selon l’auteur) sous prétexte qu’elle aboutissait, en raison de « la combinaison de l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur et de l’absence de délai d’examen de ce recours » à ce que l’employeur « soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l’exercice d’une voie de recours », ce qui constituait une violation des « exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 [garantissant le droit à un recours juridictionnel effectif] et prive de garanties légales la protection constitutionnelle de droit de propriété [de l’article 17 de la Déclaration de 1789].
Le même raisonnement peut être suivi s’agissant de la nouvelle réglementation en matière de délai de consultation du CE, la seule différence étant qu’il ne s’agit pas là de la protection du droit de propriété de l’employeur garantit par l’article 17 de la Déclaration de 1789 mais du droit à consultation du CE garanti par le 8ème alinéa du préambule de 1946.
Pour reprendre les termes mêmes du Conseil constitutionnel de la décision Foot Locker en l’amendant quelque peu, la combinaison de l’absence d’effet suspensif du recours du comité d’entreprise et du caractère automatique de la mise en jeu des dispositions des articles L. 2323-3-3 et R. 2323-1-1 du Code du travail aboutit à ce que le comité d’entreprise puisse être privé des droits tirés du 8ème alinéa du préambule de 1946 en dépit de l’exercice d’une voie de recours.
Heureusement, la parade existe...
Heureusement, il existe une parade à cette application stricte de la loi de sécurisation de l’emploi et c’est la Cour d’appel de Paris qui nous a fournie cette parade par une très belle ordonnance du 16 septembre 2015. Cette ordonnance, à la portée considérable, n’a pas encore eu la publicité qu’elle méritait à ce jour et reste encore largement méconnue. Mais ce n’est plus qu’une question de temps.
Cette ordonnance ouvre en effet la possibilité, de manière additionnelle à la saisine du juge des référés, d’effectuer une seconde démarche devant le juge afin d’obtenir une ordonnance sur requête suspendant de manière conservatoire le processus de consultation dans l’attente de la décision à intervenir du juge des référés.
Cette faculté résulte des articles 93 et suivants du Code de procédure civile qui prévoient la possibilité d’obtenir du juge « une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Il convient de souligner que cette ordonnance est obtenue de manière non contradictoire, c’est-à-dire sans que l’employeur n’ait été appelé à faire valoir ses observations.
Dans son ordonnance du 16 septembre 2015, la Cour d'appel de Paris a ouvert cette nouvelle voie procédurale en droit collectif du travail, par un attendu de principe très clair :
« Considérant au regard des textes visés, des pièces fournies au soutien de la requête et des délais impartis pour saisir le juge des référés qui plaçaient le CHSCT hors délai pour émettre l’avis tel que prévu par l’article L. 2323-3, le CHSCT était légitime à requérir la prolongation du délai de consultation jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes présentées dans l’assignation en référé présentée devant le président du tribunal de grande instance de Paris sauf à vider de son sens le processus de consultation des organes de représentation du personnel en cas de projet important ayant des conséquences sur les conditions de travail d’emploi et des conditions de vie des salariés dans l’entreprise ».
Il ne s’agit pas là du moindre paradoxe de cette législation qui se voulait ouvertement protectrice des intérêts des employeurs : en cherchant à trop verrouiller un système, c’est le législateur lui-même qui rend aujourd’hui nécessaire et justifié ce recours à l’ordonnance sur requête afin d’éviter un déni de justice ; non seulement la suspension reste ainsi toujours possible mais celle-ci intervient désormais dans un premier temps de manière non contradictoire, sans que l’employeur puisse faire valoir ses observations. Le seul bémol à cette solution, au-delà de son caractère non contradictoire, est que les ordonnances sur requête sont toujours très difficiles à obtenir et que, à Paris en tout cas, les juges chargés de délivrer de telles ordonnances ne sont pas (encore) des habitués de la matière sociale.
D’un point de vue pratique, il conviendra donc désormais de procéder de la manière suivante :
- en cas d’insuffisance de l’information transmise, dès la première réunion, chercher à obtenir un accord de la direction pour proroger les délais, accord qui devra faire l’objet d'un accord collectif en bonne et due forme selon les nouvelles modalités de l'article L. 2323-7 issues de la loi du 17 août 2015, autre usine à gaz du législateur actuel) et subsidiairement seulement, "en l'absence de délégué syndical" conclure un accord dans le cadre d’une délibération du comité d’entreprise prise à la majorité de ses membres titulaires (et évidemment aussi d’une expression de volonté « claire et explicite » de l’employeur. Attention : conserver les bandes d’enregistrement !) ; la faculté de désigner un expert libre doit également être sérieusement envisagée si nécessaire pour « gagner » un mois de plus en cas d’absence de saisine du CHSCT ;
- à la moindre difficulté et refus de l’employeur de proroger les délais, il conviendra d’être particulièrement réactif et de ne pas attendre en saisissant le plus tôt possible le juge des référés : si l’employeur n’accepte pas d’office de proroger les délais (avec délibération du CE), c’est dès la première réunion qu’il convient d’envisager de saisir le juge et de désigner un représentant pour agir en justice, surtout si le délai est d’un mois ;
- en cas de refus de consultation du CHSCT, il faut que ce dernier s’autosaisisse immédiatement sans attendre (par une demande de réunion extraordinaire) et qu’il saisisse immédiatement le juge ;
- s’il s’avère que l’audience est fixée à une date postérieure au délai de consultation, ou si, lors de l’audience, le délibéré est reporté à une date postérieure audit délai, il conviendra d’effectuer immédiatement une démarche pour obtenir une ordonnance sur requête non contradictoire ; il conviendra bien évidemment à cet effet de mettre en exergue le chemin déjà tracé par la Cour d’appel de Paris dans son ordonnance du 16 septembre 2015.