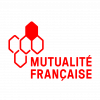Construire et financer la protection sociale d’aujourd’hui et de demain
La Sécu, une octogénaire bien vivante !
Le colloque organisé par huit fondations –Espace-Marx, la Fondation Copernic, la Fondation de l’écologie politique, la Fondation Jean Jaurès, la Fondation Gabriel Péri, la Fondation Pour un autre monde (Pam), l’Institut La Boétie, et l’Institut Tribune socialiste (ITS)– « La «Sécu», une octogénaire bien vivante!« , les 3 et 4 octobre. a été un grand moment sur le fond : ce fut l'occasion d'un large débat sur tous les sujets y compris les plus délicats.
Je vous communique ci dessous mon exposé introductif dont les objectifs ont été totalement respectés La Sécu, une octogénaire bien vivante !
Je suis intervenu dans la préparation de ce colloque au titre de l‘Institut Tribune Socialiste qui gère le patrimoine politique et intellectuel du PSU, dans toutes ses composantes -et il y en a eu beaucoup en 29 ans d’existence, de 1960 à 1989. En préparant cette introduction je n’ai pu m’empêcher de penser qu’en 2025 nous ne célébrons pas uniquement les 80 ans de la Sécu, mais aussi les 120 ans du premier Parti Socialiste Unifié, plus connu sous le nom de SFIO (Section française de l’Internationale ouvrière), résultat de la fusion, en 1905, du Parti Socialiste Français de Jean Jaurès, le fondateur de l’Humanité, et du Parti Socialiste de France de Jules Guesde.
Une unité qui ne les a pas empêché, cinq ans après, de s’opposer sur la première loi d’assurance sociale, la loi sur les retraites ouvrières et paysannes de 1910. D’un côté le rejet par Guesde d’une cotisation imposée aux salariés. En écho à la « retraite des morts » de la CGT anarcho-syndicaliste de la Charte d’Amiens, au regard d’un âge de départ à la retraite à 65 ans supérieur à l’époque à l’espérance de vie des travailleurs. De l’autre le souci de Jaurès d’obtenir « un premier effet », d’avoir « un point d’appui » pour progresser dans le sens de « la justice sociale ».
Je voudrais rassurer ceux qui pourraient être inquiets de mes propos : je ne vous propose pas de refaire le congrès de Tours à l’envers et d’unifier l’ensemble de la gauche. D’autant que depuis 1920 les courants se sont diversifiés, comme l’illustre le fait que nous soyons huit fondations, pour gérer nos différents héritages. Si j’ai voulu rappeler cette histoire un peu oubliée c’est qu’elle illustre ce que nous avons voulu faire ensemble : nous ne sommes pas d’accord sur tout, mais nous souhaitons, à l’occasion de son 80ème anniversaire manifester notre attachement à cette belle institution de la République qu’est la Sécurité sociale.
Nous ne sommes pas forcément d’accord sur tout disais-je : je voudrais l’illustrer avec un exemple. Certains d’entre nous utilisent le terme d’Etat-providence de façon positive, considérant que c’est une forme de laïcisation de la providence divine. D’autres le récusent en rappelant l’origine d’une expression utilisée par les libéraux au 19ème siècle de façon clairement péjorative. De même certains utilisent le terme d’Etat-social, considérant qu’il rappelle l’obligation pour l’Etat d’assurer la protection des citoyens, et plus généralement des personnes. D’autres rappellent l’origine bismarckienne de ce terme et considèrent qu’elle est la porte ouverte à l’étatisation et à la remise en cause de l’autonomie de la Sécurité sociale.
En fait nous nous sommes rapidement mis d’accord pour utiliser le terme de Sécurité sociale, héritage du Conseil National de la Résistance qui prévoyait dans son programme du 15 mars 1944, « Les jours heureux », (je cite, et tous les mots comptent) « un plan complet de Sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’Etat ».
Je ne vais pas faire dans cette introduction, ni l’exégèse ni l’analyse de la postérité de cette phrase d’à peine trois lignes qui est restée un des acquis principaux du programme du CNR alors que beaucoup d’autres ont reculé : ce sera l’objet de la première table ronde. Je voudrais toutefois rappeler que quatre ans après, le droit à la Sécurité sociale va devenir un des droits humains fondamentaux : « Toute personne en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale » affirme la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948 dans son article 22.
Ces 80 ans sont l’occasion de manifester notre attachement à cette idée-force qu’est la Sécurité sociale, une idée-force, c’est à dire une idée qui peut changer les choses. Notre attachement, et pas seulement sa défense, au moment où elle est attaquée, récemment avec une réforme des retraites rejetée par toutes les organisations syndicales et par une grande majorité des Français ; ou encore en cette rentrée avec les mesures annoncées pour l’assurance-maladie.
D’ailleurs j’observe le silence assourdissant de l’exécutif sur cet anniversaire.
Notre attachement et surtout notre conviction de la capacité de la Sécurité sociale à relever les défis auxquels elle est confrontée : ceux liés à l’allongement de l’espérance de vie, ceux de l’accompagnement des personnes âgées dépendantes, de l’accès de tous aux soins, de la lutte contre les nouvelles formes de pauvreté comme celles des familles monoparentales, les « mamans solo », ou encore pour contribuer à résoudre la crise climatique. C’est donc un quatre-vingtième anniversaire tourné vers l’avenir que nous voulons célébrer.
Ce que nous entendions célébrer aujourd'hui et demain c’est l’ordonnance du gouvernement provisoire de la République française du 4 octobre 1945 « portant organisation de la Sécurité sociale » : ordonnance fondatrice qui sera suivie de nombreuses autres, et ce dès le 19 octobre. Un ensemble qui sera intégré en 1956 dans le Code de la Sécurité sociale. Cela nous amène à un autre débat entre nous : celui du champ couvert pas la Sécurité sociale. Schématiquement il y a deux conceptions.
La première, la plus restrictive, c’est la Sécurité sociale au sens institutionnel, celle qui est visée par les lois de financement de la sécurité sociale (les LFSS) : le régime général bien sûr avec ses quatre branches, la maladie à laquelle on a tendance à l’identifier avec le beau symbole de la carte Vitale, la retraite, la famille et la branche recouvrement des cotisations et contributions, mais aussi les autres régimes comme le régime agricole ou celui des indépendants.
La seconde est plus large. C’est celle de tous les dispositifs de protection sociale dits « obligatoires », i.e. , d’un côté, la retraite des fonctionnaires d’Etat (qui est dans le budget de l’Etat), la retraite complémentaire des salariés (Agirc Arrco), l’assurance chômage (qui pour les fondateurs aurait dû être intégrée dans la Sécurité sociale), et de l’autre les minimas sociaux (minimum vieillesse, allocation aux adultes handicapés, RSA, par exemple). C’est d’ailleurs cette définition de la Sécurité sociale qu’a retenu l’Union européenne pour coordonner des systèmes de sécurité sociale nationaux très différents d’un pays à l’autre.
En fait nous n’avons pas vraiment tranché entre ces deux conceptions et cela pourra faire l’objet de débats dans les quatre table-rondes que nous avons organisées autour des quatre branches de la Sécurité sociale : l’assurance maladie, la retraite, les prestations familiales et le financement.
Quoiqu’il en soit la Sécu c’est aujourd’hui une partie importante de la richesse nationale :
- plus que le budget de l’Etat si on se limite au champ des LFSS (666 Mds € contre 444 Mds €).
- un tiers du PIB si on prend la définition la plus large).
C’est volontairement que je parle ici de richesse et non pas de charges, car la Sécu contribue à la richesse du pays; comme l’a illustré le dossier d’Alternatives économiques « Vive la Sécu », de ce mois-ci : Non, la Sécu n’est pas une « charge » pour l’économie.
Il n’en demeure pas moins que la part de la solidarité dans la richesse nationale fait débat. Comme fait débat aussi la façon de mesurer cette richesse, avec un PIB qui n’intègre pas les dégâts du progrès ». Comme fait débat plus encore … l’absence de débat démocratique sur ces questions, celles-ci étant ramenées à un concept comptable : celui du « trou de la Sécu ».
A ce sujet je voudrais tordre le coup à une idée reçue et entretenue : ce n’est pas le modéle social qui est à l’origine de la crise de la dette. La dette de la Sécu c’est moins de 10 % de la dette publique et, contrairement à la dette de l’Etat, elle est remboursée avec la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) que nous payons tous, tous les mois.
Sur ces trois débats nous n’avons pas forcément les mêmes idées sur ce qu’il faudrait faire. Mais nous avons, je crois, des convictions communes :
- Le refus de la stratégie d’endiguement de la Sécu développée par les néolibéraux depuis plusieurs décennies, et qui consiste, au nom du soit disant « ras le bol fiscal », à plafonner, voir à diminuer la part du PIB consacrée à la Sécu.
- La nécessité d’articuler Sécurité sociale et sécurité climatique (ou sécurité environnementale), car la crise climatique génère de nouveaux risques sociaux.
- La nécessité de mettre plus de démocratie dans le système et de renouer avec la notion de démocratie sociale dont les conclaves et autres Ségur ne sont que de pales imitations.
Toutes ces questions ont été abordées avec une séance de clôture pour laquelle nous ont rejoints les deux secrétaires générales de la CFDT et de la CGT et le président du Cese (Conseil économique sociale et environnementale). Une manifestation de l’attachement des forces syndicales et de la société civile à la Sécu. Une Sécu qui, à 80 ans, est encore bien vivante.
Vive la Sécu !
- Protection sociale parrainé par MNH
- Relations sociales