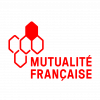Rapports au travail de l'ESS : une première approche critique
Même si l'on peut débattre de ces chiffres « magiques », souvent mis en avant (10 % du PIB, 12,5 % de l’emploi salarié privé etc.), l’économie sociale et solidaire (ESS) représente une réalité incontestable. Présente dans bien des activités (de la banque à la culture, des assurances à la mécaniques, du sport à l’habitat et autres), l’ESS n’est pas à proprement parler un secteur économique et c’est souvent en cela que beaucoup ont du mal à l’appréhender. Elle n’est pas non plus l’économie du social et de la réparation. Elle n’est pas une économie de l’intention mais une économie des formes que ses statuts, mutualistes, coopératifs et associatifs dans leur diversité lui donnent. L’ESS se veut avant tout comme un « entreprendre autrement » et, en tant que tel, devrait aborder les questions du travail au sein de ses entreprises « autrement », qu’il s’agisse des relations du travail, de l’organisation de la production etc. À ce titre, une revue comme Travailler au Futur ne saurait en ignorer l’importance et les spécificités.
« Entreprendre autrement » ?
L’évoquant, j’ai employé les mots « se veut » ou « devrait », tant il est vrai que tout observateur (fût-il au sein de l’ESS et aussi engagé soit-il dans sa défense et son développement) est confronté aux insuffisances de l’« autrement » en ces domaines du travail. Ce sera là l’objet de cette chronique (critique mais animée du désir de voir cet « entreprendre autrement ») se constituer résolument en alternative et devenir « la norme de l’économie de demain », comme le revendique Jérôme Saddier, président d’ESS-France, structure faîtière de l’ESS.
En remarque liminaire, il faut préciser que, contrairement aux idées communes sur le sujet, les salariés de l’ESS (plus de deux millions) sont des salariés de droit commun au même titre que dans les autres formes d’entreprises et soumis aux mêmes règles. L’exception est celle des coopératives de production et de travail (SCOP, CAE et SCIC) où les travailleurs peuvent se retrouver dans une position double : au regard des lois du travail et de la protection sociale, ils sont des salariés comme les autres et, au titre des statuts, ils sont coopérateurs donc co-entrepreneurs.
Mais cette situation juridique et sociale, pour l’essentiel banalisée, implique-t-elle pour autant que les salariés, quelles que soient leurs responsabilités, soient, au sein d’entreprises se proclamant « autres », fondées sur la solidarité et la démocratie, confrontés aux mêmes situations et aux mêmes tensions qui prévalent peu ou prou au sein des entreprises ordinaires ?
La question est essentielle car elle conditionne pour beaucoup de gens en quête d’alternatives, l’adhésion qu’ils peuvent montrer à l’égard d’une ESS de transformation et émancipatrice. Cette question détermine une position univoque de beaucoup de syndicalistes qui ne considèrent l’ESS qu’en tant que secteur revendicatif, aux réalités très diverses, et non en tant que potentiel de convergences pour une société plus solidaire et plus démocratique.
Puisque les syndicats sont évoqués, revenons sur des éléments d’histoire ayant sans doute mené à cette situation.
Dans cette approche historique, ils nous faut distinguer, au sein de l’ESS, ce qui procède d’une part des initiatives d'individus en réponse à des besoins sociaux, à des projets communs et confrontés aux violences et prédations libérales, et d’autre part ce qui est la formalisation des œuvres charitables religieuses et philanthropiques.
Nous nous en tiendrons ici pour l’essentiel aux premières. L’associationnisme, tel que Michèle Riot-Sarcey et Jean-Louis Laville l'évoquent dans Le Réveil de l’Utopie (éditions de L’Atelier), est, à l’origine, le fait de gens du peuple et de bourgeois révoltés dans une dialectique avec les penseurs du temps, tels que Saint-Simon ou Fourrier, Proudhon ou Pierre Leroux.
Les premières sociétés de secours mutuel, associations ouvrières de production, coopératives de consommations et caisses populaires de crédit ont un terreau commun. Les formes premières du mouvement ouvrier ont surgi de ce dernier.
En cette année de commémoration du cent-cinquantième anniversaire de la Commune de Paris, prenons un seul exemple : celui d’Eugène Varlin, martyr de la Semaine sanglante. Eugène Varlin était à la fois militant socialiste libertaire, animateur de sa mutuelle ouvrière et cofondateur de la Marmite, premier restaurant coopératif parisien aux innovations multiples. Plus tard, Fernand Pelloutier, dans sa conception des bourses du travail, a intégré les premières formes syndicales, les mutuelles ouvrières, les associations ouvrières de production, les associations d’éducation populaire etc. sous un même toit et pour une même zone.
Développement séparé entre formes de l’ESS et organisations du mouvement ouvrier
Dans les débats politiques de la fin du XIXe siècle, des fissures sont apparues et s'élargissant, du moins en France. Karl Marx voyait « l’’économie des travailleurs » dans les coopératives mais il a aussi émis des réserves, dans des œuvres ultérieures : beaucoup de ses épigones (en premier lieu desquels les guesdistes) ont de ce fait pris leurs distances. Un même phénomène a touché des anarchistes émules de Bakounine. Charles Gide, premier grand théoricien de l’économie sociale, a vainement tenté de défendre son programme de République coopérative devant les congrès socialistes.
Pour l’essentiel séparé entre formes de l’ESS et organisations du mouvement ouvrier, ce développement a eu en France des conséquences déplorables pour toutes. Aux premières, il a manqué un lien aux travailleurs et des dynamiques sociales. Il a manqué des bases pour le développement de la solidarité et de la démocratie, la gestion d’« utopies concrètes » aux secondes.
La situation n'a pas été la même partout. Ainsi, en Italie, les familles coopératives (formes essentielles de l’économie sociale) se sont constituées et ont évolué en lien avec les forces syndicales. Des militants ouvriers, syndicalistes ou politiques se sont investis dans les mutuelles, les coopératives et les associations mais en ordre dispersé et sans élaborer une théorie de l’ESS mais du moins des outils spécifiques en liens avec leurs engagements. Cela a eu deux conséquences. D’une part il y a eu les errements de beaucoup de notables mutualistes et coopératifs durant l’Occupation (mais ces errements ont aussi été ceux de responsables de la CGT, comme le montrent les instances de celle-ci en juillet 1940). D’autre part, sans références sociales, les entreprises de l’ESS ont adopté une gestion se voulant pragmatique envers leurs salariés, c’est-à-dire selon l’esprit des temps. En 1984, René Teulade qui a été président de la Fédération nationale de la mutualité française, avouait : « Je crois (…) que ce qui nous a manqué dans cette période, jusqu’en 1960, voire 1967, c’est une véritable ouverture vers le monde du travail » (René Teulade et Pascal Beau, La Mutualité Française, Ramsay, 1984). Durant ces années, la gestion des entreprises de l’ESS a oscillé entre paternalisme et banalité.
Une société sous dominante néolibérale va compliquer la situation.
Les théories managériales ont fait florès et les dirigeants, tant les élus que les « technostructures », ont assez vite cédé aux sirènes de la modernité, d’autant que, si certaines entreprises ESS ont disparu (comme les coopératives de consommation), certaines grandes entités ont connu une réelle croissance, comme dans le secteur des assurances ou de la banque.
Ces dernières années, ce a notamment été le cas des mutuelles de santé engagées dans des regroupements et fusions qui ont fait passer leur nombre de plus de 6 000 il y a vingt ans à moins de 400 aujourd'hui. Dans les années 1960, dans bien des structures mutualistes, les militants étaient en charge de la collecte des cotisations ; aujourd’hui, les structures qui comptent souvent plusieurs centaines de milliers d’adhérents, voire plusieurs millions, sont confrontées aux théories des « big data ».
Ce n’est pas sans conséquences sur les paradigmes mutualistes ou coopératifs. Quand David Graebber (anthropologue et géographe américain récemment décédé) affirmait que l’essentiel de la victoire libérale des dernières années était une victoire idéologique, cela concernait aussi tous ceux qui, au-delà de leurs convictions, ont considéré les règles de la gestion libérale comme « naturelles ». Cela a frappé les entreprises de l’ESS de plein fouet.
Il est vrai que, au-delà de la croissance des structures, activités et interventions sont de plus en plus complexes et demandent une professionnalisation accrue.
Comment y répondre ?
Les traditions d’éducation populaire qui assuraient la promotion sociale, tant d’adhérents que de salariés, se sont effritées jusqu’à quasiment disparaître. Le pouvoir des élus s'est pareillement s’effacé au profit des technostructures qui ont imposé l’idée que les procédés qu’ils mettent en œuvre (qu’il s’agisse de comptabilité, d’investissements ou de « ressources humaines ») sont purement techniques et politiquement neutres.
Rares sont les dirigeants élus de l’ESS qui, à l’instar de Jean-Louis Bancel (ancien président du Crédit coopératif), s’engagent, face aux autorités européennes, pour un plan comptable distinct pour les entreprises estampillées « non-profit » devant des normes IFRS, purement libérales.
Les grandes unités de l’ESS (et des moyennes aussi) ont confié leur sort à des générations de MBA, aux filières DRH indifférenciées et aux parcours idéologisés à l’extrême, même quand leurs titulaires aspirent à un entrepreneuriat plus social, davantage porteur de sens. Un vieil adage disait qu’il était plus facile et préférable de professionnaliser un militant que de conscientiser un technocrate. Il est oublié depuis belle lurette.
Ainsi, une grande mutuelle d’assurance ayant connu son développement dans ses liens aux confédérations syndicales a, dans un temps où elle a certes connu quelques errements en rupture avec l’esprit de ses fondateurs, confié ses RH à un « technicien » venu de la grande distribution, secteur connu pour les violences de ses relations sociales. Depuis, l’entreprise revient à ses valeurs mais l’exemple est très significatif.
Dans le contexte abordé ci-dessus comment voir émerger cet « entreprendre autrement » dans le champ du travail et des relations sociales des organisations ?
Contrairement à ce que des syndicalistes affirment, les entreprises de l’ESS, mutualistes et coopératives, ne sont pas des pandémoniums sociaux. Pour certaines, elles connaissent des situations plutôt favorables et, pour le plus grand nombre, identiques à celles des entreprises ordinaires comparables.
Mais peut-on se contenter de ces équivalences s’agissant de structures se revendiquant de valeurs solidaires et démocratiques ?
Ce qui est regardé sévèrement (mais en quelque sorte considéré comme normal) au sein d’un groupe de grande distribution capitaliste paraît plus scandaleux s’agissant d’un groupe proclamant sa forme coopérative. Il en est de même pour une banque qui communique sur son lien aux gens et en vient à maltraiter ses salariés pour accroître ses profits.
Pour les gens ayant participé à d’innombrables débats publics sur l’ESS, ces dérives lui sont amèrement reprochées, autant que des pratiques mercantiles banalisées. La situation est d’autant plus intolérable que bien des élus mutualistes ou coopératifs sont eux-mêmes des salariés en activité ou retraités. Cette banalisation se retrouve dans les options prises par le principal groupement d’employeurs de l’ESS. Dans la recherche d’une reconnaissance à tout prix, l’Union des employeurs de l’ESS (UDES) a été amenée à coller aux positions patronales les plus radicales, tant au temps de la loi El Khomry dite « loi sur le travail », en 2016-2017, que des ordonnances Pénicaud-Macron. Cet engagement a failli déboucher sur une union entre l’UDES et la Confédération des PME qui, si elle a échoué, a néanmoins mené une bonne partie des employeurs du médico-social à rejoindre l’organisation lige du MEDEF.
Où est l’ « autrement » dans ces conditions ?
Notons que des groupements existent qui se sont refusés à pareilles options : le Groupement des organismes employeurs de l’économie sociale (GOEES) et l’Union fédérale d’intervention des structures culturelles (UFISC) qui agit au sein du monde de la culture. Mais ils sont hélas très minoritaires. La réponse à cet état de choses est peut-être à chercher du côté de l’exercice effectif de la démocratie mutualiste ou coopérative pour pallier l’éloignement des élus et des technocrates des adhérents, de leurs besoins et de leurs ressentis. Une indéniable dialectique existe entre affaiblissement de la participation des adhérents et gestion banalisée des structures.
Cependant, depuis peu, on entend de nouveaux discours, on perçoit de nouvelles orientations cherchant une meilleure cohérence entre valeurs revendiquées et pratiques mises en œuvre. Jusque là, ce sont essentiellement des mutuelles et coopératives qui ont été abordées. Pourtant, l’essentiel du salariat de l’ESS n’est pas là : pour les deux tiers il est au sein des associations. C’est sans doute là que les problèmes les plus sensibles résident. Là encore, il faut distinguer les œuvres (structures, souvent parmi les plus importantes, héritées des charités religieuses et philanthropiques) et les associations que par principe qualifiées de citoyennes.
Pour les premières, nous nous retrouvons souvent dans la situation des entreprises de l’ESS précédemment évoquées. Pour les secondes, nous sommes, le plus souvent, face à des structures de moindre taille, davantage confrontées aux circonstances du temps. Dans les deux cas, bénévoles et salariés coexistent en leur sein, bien que la professionnalisation des interventions donne une place de plus en plus grande aux derniers.
Pour l’essentiel, ces associations sont soumises à des tensions entre leurs activités d’intérêt général, qui vont croissant, et leurs financements décroissants. Alors que l’État se désengage tout en ayant des exigences de plus en plus fortes (« faire plus avec moins de financement »), les collectivités territoriales voient leurs ressources se réduire par rapport à leurs engagements, notamment dans le cadre de la décentralisation et des « défausses « étatiques. Par ailleurs, dans les champs d’intervention des associations, le libéralisme imprime sa marque.
La marchandisation va bon train. Dans des domaines longtemps circonscrits à l’action publique et/ou aux associations, des opérateurs privés se présentent et les règles nouvelles (nationales ou communautaires) laissent libre cours à leurs prédations. Ainsi, le plus souvent, ils se réservent la part la plus solvable des nouveaux « marchés », notamment sociaux.
Pour le reste, les règles de la concurrence imposent des « appels d’offres » des « marchés » où les associations se retrouvent en lutte les unes avec les autres et où d’autres opérateurs, relevant du « social business », se taillent souvent la part du lion.
Mais comment être moins disant dans un marché social, culturel ou autre sans dégrader ce qui constitue souvent l’essentiel de coût de l’activité, c’est-à-dire les salaires et les conditions de travail des salariés ?
Certains nouveaux secteurs du social (notamment les services aux personnes, dont l’aide à domicile) sont le lieu de développement d’un nouveau prolétariat, féminin en quasi-totalité, dans lequel bas salaires et précarité dominent. Bien sûr, toutes les études sur la qualité de vie au travail dans le monde associatif soulignent jusqu’à présent le sens et les valeurs mais, quoi que l’on en dise, le sens n’assure pas les fins de mois difficiles.
D’autres associations connaissent de graves tensions et on assiste à des conflits de travail sur les salaires et les conditions de travail, voire la gestion. Emmaüs, France-Terre d’Asile et bien d’autres ont été touchées. Les travaux de Matthieu Hély sont à ce sujet très éclairants. Le secteur associatif est d’autant plus vulnérable qu’il connaît une syndicalisation très marginale et l’émergence d’Asso (syndicat spécifique au sein de Solidaires) n’a guère changé la donne.
Pour finir cette première approche critique des rapports travail/ESS, avant de donner la parole à des militants et chercheurs de chaque famille, abordons cependant de nouvelles dimensions de l’ESS, porteuses d’espoirs dans la perspective de transformation et d’émancipation. Ces « bonnes nouvelles » viennent du mouvement coopératif. Il y a bien sûr le développement continu (quoique qu’encore modeste) des coopératives de production, qu’il s’agisse de créations ou de reprises d’entreprises après lutte. Les SCOP (ex-coopératives ouvrières de production, aujourd’hui, par un affadissement du sens, « sociétés coopératives et participatives), ne sont pas exemptes de tensions quant au travail, aux salaires, aux conditions de l’activité mais les travailleurs y sont maîtres de l’affaire, élisent et peuvent démettre leurs dirigeants. Elles sont un lieu privilégié des engagements et des valeurs de l’ESS. Les salariés sont aussi présents au sein des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) qui portent un projet commun avec l’ensemble des parties prenantes.
À l'origine, les coopératives d’activité et d’emploi offraient un cadre collectif, notamment garant de protection sociale, à des porteurs de projets et créateurs d’entreprises ; aujourd’hui, elles représentent des réponses concrètes à l’ubérisation du travail et à toutes les formes de « dé-salarisation ». Le groupe SMart offre ainsi un cadre coopératif à l’activité de plus de cent mille personnes en Europe. SCOP et CAE offrent aux travailleurs des plates-formes un cadre pour s’émanciper de la surexploitation qu’ils subissent
L'’ESS entretient donc des rapports complexes au travail mais se dessinent des formes transformatrices en son sein. Des mouvements très perceptibles y montrent un réinvestissement des valeurs, des principes, des pratiques démocratiques et d’une innovation sociale qui n’est pas, comme elle est trop souvent présentée, une simple adaptation au cadre libéral mais la recherche de voies nouvelles pour répondre à la crise démocratique, sociale et environnementale que nous traversons.