Organisations
Baromètre santé-social 2025 FNMF/AMF : la santé face au défi des inégalités
La Mutualité Française et l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) publient le 20 novembre 2025 la 3e édition du Baromètre santé-social, véritable panorama de l’offre de soins et de l’action sociale. Face aux disparités territoriales qui fragilisent notamment l’accès aux soins, ce rapport insiste sur la force de la mobilisation locale et des partenariats nécessaires entre mutuelles et territoires.
L’accès aux soins reste le point de friction majeur entre les attentes des Français et la réalité du terrain. Au cours des 12 derniers mois, 65% d’entre eux ont renoncé à se soigner. Les tensions déjà observées sur la densité de médecins généralistes, avec plus de 6 millions de Français sans médecin traitant selon les estimations de la Drees, se sont non seulement maintenues, mais souvent aggravées dans les zones rurales et périurbaines. Tel est le constat du 3e Baromètre santé-social publié conjointement, le 20 novembre 2025, par la Mutualité Française et l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF).
Déserts médicaux : une France à plusieurs vitesses
Réalisé à partir d’indicateurs issus de sources publiques, le Baromètre santé-social 2025 rappelle que l’accessibilité aux soins varie aujourd’hui d’un facteur 1 à 7 suivant le territoire. La légère hausse du nombre de généralistes, soit +1% depuis le baromètre 2023, ne suffit pas à enrayer les déserts médicaux qui concernent 87% de la population. Cette situation inacceptable nourrit un sentiment d’abandon chez de nombreux citoyens.
Cependant, l’étude souligne que des solutions émergent de la base. Les Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), soutenues par les maires et les mutuelles, les maisons de santé ou encore les contrats locaux de santé (CLS) continuent de se déployer pour organiser les soins non programmés et améliorer la coordination ville-hôpital. Ces dispositifs de proximité sont la preuve qu’une médecine territoriale et collaborative est possible. En parallèle, la Mutualité Française déploie près de 3 000 services de soins et d’accompagnement mutualistes pour garantir un accès équitable à la santé partout sur le territoire. Des initiatives originales portées avec les municipalités permettent d’aller directement à la rencontre des patients, à l’instar du Buccobus, un véhicule itinérant qui propose des soins dentaires en milieu rural.
La santé mentale au cœur de l’urgence sanitaire
Cette 3e édition consacre également un volet spécifique à la santé mentale et confirme l’ampleur du défi de la Grande cause nationale. Rappelons qu’au mois de septembre 2025, la Mutualité Française, l’Institut Montaigne et l’Institut Terram se sont associés pour publier une enquête inédite intitulée “Santé mentale des jeunes de l’Hexagone aux outre-mer. Cartographie des inégalités”. Parmi les enseignements de cette étude, il apparaît qu’un jeune sur quatre de 15 à 29 ans présente des signes de dépression, avec des taux alarmants dans les territoires ultramarins (jusqu’à 52 % en Guyane).
Derrière la tension constante sur le nombre de médecins généralistes, se cache une pénurie préoccupante de spécialistes. Le baromètre met en évidence des déséquilibres critiques dans la densité de psychologues, de psychiatres et de pédopsychiatres en fonction des territoires. Ainsi, l’attente de prise en charge dans un centre médico-psychologique (CMP), en particulier en pédopsychiatrie, se mesure régulièrement en mois.
Face à ce constat, les initiatives mutualistes de proximité et les conseils locaux en santé mentale (CLSM), dont le maillage progresse, sont plus que jamais essentiels pour offrir une réponse rapide et coordonnée. Les formations aux premiers secours en santé mentale, les actions de prévention dans les écoles ou les dispositifs d’écoute pour les agents territoriaux montrent la voie d’une santé mentale de proximité, ancrée dans la communauté.
Inégalités environnementales
Au-delà de l’accès aux soignants, ce rapport met en lumière deux autres crises silencieuses qui pèsent sur le quotidien des Français. La première concerne la santé environnementale. Actuellement, 72% des Français s’inquiètent de l’effet des facteurs liés à l’environnement sur leur santé. La qualité de l’eau potable reste préoccupante et inégale entre les départements. Les données de la Base Sise Eaux révèlent que des millions de Français sont encore alimentés par de l’eau non conforme aux limites de qualité, notamment en raison de la présence de pesticides. De même, l’exposition aux particules fines (PM2,5) accentue le risque de maladies respiratoires dans les zones urbaines et industrielles.
Se superposant souvent aux inégalités sociales, ces sujets de santé environnementale sont cruciaux pour les maires et présidents d’intercommunalité qui agissent et innovent au quotidien pour limiter l’exposition de leurs administrés aux pollutions, dont les plus fragiles. En complément, les mutuelles déploient, en lien avec des acteurs locaux – collectivités territoriales, agences régionales de santé – des actions de promotion de la santé et de prévention auprès du grand public.
Autonomie : des besoins croissants
Enfin, le baromètre propose un focus sur la crise du secteur de l’autonomie dont les besoins de prise en charge sont en forte croissance en milieu urbain. Outre le recul de l’offre de places en établissement pour personnes âgées depuis 2021, la forte disparité des tarifs en Ehpad rend l’hébergement parfois inabordable pour les classes moyennes et modestes, avec un coût moyen de 95€ par jour hors aide sociale.
Les longs délais de traitement des dossiers par les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) demeurent problématiques, soulignant la lourdeur administrative face à la vulnérabilité. Amorce de changement positif : des collaborations entre les acteurs locaux et les mutuelles facilitent l’accompagnement des seniors et de leurs aidants dans le bien-vieillir et leur permettent de rester à domicile le plus longtemps possible.
Plus de détails sur:
- Protection sociale parrainé par MNH
- Relations sociales
- Santé au travail parrainé par Groupe Technologia
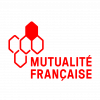





Afficher les commentaires
L'’AMF et la Mutualité Française appellent à un engagement colle
Deux ans après la précédente édition, le bilan est sans appel : les indicateurs clés stagnent ou régressent, révélant un ancrage des fragilités sociales et sanitaires, ainsi que des disparités toujours plus importantes entre les territoires. Bien que le baromètre montre l’efficacité d’une coopération étroite entre les élus et les acteurs mutualistes, cela n’exclut pas la nécessité d’une action publique plus ambitieuse et adaptée aux réalités locales.
Avec cette troisième édition du baromètre santé-social, l’AMF et la Mutualité Française souhaitent éclairer le débat public sur les enjeux sociaux et sanitaires majeurs qui préoccupent les citoyens. Le baromètre s’articule autour de deux axes : d’une part, la santé, avec l’accès aux soins, la santé environnementale et la santé mentale, la nouveauté de l’édition 2025 du baromètre, et d’autre part, le champ social, englobant la petite enfance, la prise en charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Le baromètre permet de suivre l’évolution des grands indicateurs du bien-être collectif mais surtout d’objectiver les disparités départementales.
Les résultats de cette troisième édition témoignent d’une situation générale qui ne s’améliore pas, stagne voire se dégrade pour certains domaines visés par le baromètre.
Accès aux soins : l’urgence de renforcer la proximité
La santé, et plus spécifiquement l’accès à une offre de soins en proximité, accessible financièrement, reste un sujet de préoccupation majeure des citoyens. En 2025, près de deux tiers (65 %) des Français ont renoncé à des soins, une proportion en hausse de trois points par rapport à 2024[1]. Différents facteurs expliquent cette tendance, parmi lesquels les difficultés financières, les délais d’attente trop longs, l’éloignement des structures médicales.
L’offre de soins médicaux pâtit d’une démographie médicale en peine et inégalement répartie. 100 019 médecins généralistes exercent en France[2].Certains départements, comme l’Essonne ou la Seine-Saint-Denis, disposent de moins de 100 médecins pour 100 000 habitants, bien en dessous de la moyenne nationale (146), contrairement aux Hautes-Alpes (288) ou à Paris (240).
Aujourd’hui, 87 % des Français vivent dans des territoires qualifiés de « déserts médicaux »[3], et six millions n’ont pas de médecin traitant, soit près de 10 % de la population, dont environ 400 000 patients en affection de longue durée.
Le baromètre indique toutefois une stabilité de la permanence des soins avec un taux de volontariat des médecins généralistes à 39 %[4]. Celui-ci a toutefois été réduit de moitié depuis 2012 (73% )[5].
Environnement : un enjeu de santé majeur
En 2025, 72 % des Français s’inquiètent de l’effet des facteurs liés à l’environnement sur leur santé (+6 points en un an)[6]. La qualité des aliments, les pesticides, le changement climatique, la qualité de l’eau du robinet et la pollution des sols sont les cinq premiers facteurs d’inquiétude des Français pour leur santé[7].
Le baromètre enregistre une dégradation préoccupante de la qualité environnementale. La pollution de l’air aux particules fines cause chaque année 40 000 décès, soit 7 % de la mortalité nationale, avec un coût social estimé à 12,9 milliards d’euros. La qualité de l’eau recule également : en 2023, 74,7 % de la population a eu accès à une eau respectant en permanence les limites de qualité pour les pesticides[8], soit 5,5 millions de personnes de moins qu’en 2021.
L’étude met aussi en évidence une superposition des inégalités sociales et environnementales : les communes les plus pauvres comme les plus aisées peuvent être surexposées, mais pour des raisons différentes comme la proximité du trafic routier en milieu urbain ou l’usage agricole intensif en milieu rural. Ces constats appellent à construire des politiques et des actions de prévention des risques différenciées,
Santé mentale : grande cause nationale en manque de moyens
Les enjeux de santé mentale sont en progression constante depuis la crise sanitaire de 2020. Ainsi, 20 % de la population est touchée par des troubles psychiques chaque année[9] soit 13 millions de personnes. Ces troubles représentent par ailleurs la première cause d’arrêts maladie de longue durée.
Les jeunes générations sont particulièrement touchées. En effet, 1 jeune sur 4 présente des signes de dépression en 2025, soit une moyenne nationale de 25
% des jeunes de 15-29 ans, avec des taux qui atteignent 39 % en outre-mer.
Or le nombre insuffisant de psychiatres ne permet pas de répondre aux besoins de la population. 7 % des lits de psychiatrie restent fermés faute de personnel[1] et près de 40 % des établissements publics manquent de psychiatres. À cela s’ajoutent l’inégale répartition des psychiatres sur le territoire, la baisse d’attractivité du métier et le vieillissement des praticiens. La formation et le partage de certaines missions avec d’autres professionnels de santé comme les psychologues ou les infirmiers peuvent combler ces carences.
La cohésion sociale à l’épreuve
Sur le terrain social, la situation n’est guère plus encourageante. L’offre d’accueil des jeunes enfants reste bloquée à 60,3 places pour 100 enfants de moins de trois ans. Les établissements souffrent d’une pénurie chronique : 6 100 postes équivalent temps plein sont vacants depuis plus de trois mois, soit 4 % du personnel, et jusqu’à 8 % en comptant l’absentéisme.
Pour les aînés, la pression s’accroît et peut conduire à des difficultés grandissantes d’accès à l’accompagnement. Sur 7 500 Ehpad, un quart sont privés à but lucratif. Les cinq plus grands groupes concentrent 56 % de ces établissements et pratiquent les tarifs les plus élevés. Soucieux de veiller à l’accessibilité financière des établissements, les mutuelles et le bloc communal plaident pour une forme d’équilibre dans le développement de l’offre. Concernant les personnes en situation de handicap, le taux d’équipement en établissements les prenant en charge s’élève à 8,4 places pour 1 000 adultes fin 2023. Depuis 2004, le nombre de places a plus que doublé, mais des disparités territoriales subsistent.
Ce baromètre confirme l’ampleur des défis sociaux et sanitaires qui fragilisent notre pays. Mais il rappelle aussi que la réponse ne peut être fragmentée : elle doit s’inscrire dans une stratégie nationale, articulée avec les dynamiques locales. L’AMF et la Mutualité Française réaffirment leur rôle de partenaires incontournables pour construire des solutions adaptées aux territoires, en mobilisant les élus, les professionnels de santé et les assurés sociaux et leurs bénéficiaires, premiers concernés par les orientations politiques en matière de santé et de protection sociale.
Cette ambition suppose une action publique plus intégrée, des financements pérennes et une gouvernance partagée. Parce que la santé et la solidarité sont des biens communs, il est temps de transformer l’alerte en engagement collectif.
Cette troisième édition du baromètre valorise des solutions opérationnelles déployées sur le terrain par le bloc communal et les mutuelles