Organisations
Le numérique et la prévention en santé sont deux faces d’une même médaille
Pour le Dr. Isabelle Adenot, Présidente de l’Agence du numérique en santé qui s'est confiée au CRAPS (le Cercle de Recherche et d'Analyse sur la Protection Sociale): "À nous de créer les conditions de la confiance, pour réussir la généralisation d’un usage éthique et efficient du numérique et de l’intelligence artificielle en santé »
Au niveau mondial, la transformation numérique du secteur de la santé est depuis de très nombreuses années en pleine accélération.
En France, nous accusions un véritable retard : systèmes créés en silo non interopérables, manque d’acceptabilité et de confiance dans le numérique, carence de formation des professionnels et des usagers, déficit de prises en charge de dispositifs numériques, manque d’investissements dans les infrastructures numériques, insuffisance de soutien aux industriels concernés… La liste était longue…
Aujourd’hui, la stratégie d’accélération « Santé numérique » dans le cadre du plan « France 2030 » et le programme Ségur du numérique en santé ont changé la donne ! Des investissements massifs sont réalisés sur l’infrastructure numérique, l’interopérabilité des systèmes d’information, la sécurisation des données de santé, le déploiement de solutions innovantes, la formation des acteurs…
Ainsi, ces plans ambitieux ont impulsé une dynamique de transformation sans précédent. Ce qui était inconcevable hier devient parfois réalité banale aujourd’hui. Et l’avènement du numérique dans le domaine de la santé en France est incontestable. Les chiffres témoignent de l’ampleur du mouvement.
Pour exemple :
– Plus de 95 % des Français ont un carnet de santé numérique, plus de 12 millions sont allés le voir et chaque mois, depuis plus de 6 mois consécutifs, c’est 550 000 personnes de plus. 2,5 millions ont installé l’application correspondante et 30 % reviennent d’un mois sur l’autre. Les patients ont ajouté à ce jour 15 millions de documents. Tous les mois, les professionnels de santé envoient dans le Dossier médical partagé 4 fois plus de documents qu’en 15 ans de temps. Des boîtes à lettres de messagerie sécurisée ont été créées et plus de 20 millions de messages sécurisés ont été envoyés ;
– En 2021, 9,4 millions de téléconsultations de médecine générale ont été réalisées chez un praticien libéral et 1,1 million dans les centres de santé ;
– En 2021 et 2022, les lois de financement de la Sécurité sociale ont introduit des dispositifs de prise en charge dérogatoires pour les dispositifs médicaux (prise en charge transitoire et prise en charge anticipée des dispositifs numériques médicaux), qui, aux côtés du Forfait Innovation préexistant, permettent un accès plus rapide des patients aux innovations numériques ;
– Le Health Data Hub indique que plus de 1600 projets sont déposés ;
– Le dernier panorama de Bpifrance compte plus d’une centaine de sociétés associant Intelligence artificielle et santé ;
– Etc.
Toutefois, la route vers une transformation numérique complète est encore longue. Ainsi, à l’Agence du numérique en santé (ANS), le Ségur numérique 2 se profile comme une étape cruciale pour consolider les acquis du premier volet, mais surtout pour généraliser l’usage du numérique à tous les niveaux du système de santé, de la gestion opérationnelle aux soins cliniques en passant par la prévention.
Car, oui, la prévention, qui est l’art d’anticiper pour mieux préserver, s’impose comme un pilier essentiel de cette transformation. Les études et recherches convergent pour souligner l’impact positif de la prévention sur la santé publique et sur la soutenabilité financière des systèmes de santé.
La prévention revêt plusieurs facettes. Grâce aux avancées de la télésurveillance, il devient par exemple possible d’accompagner les patients de manière continue, de détecter les signes avant-coureurs de complications et d’intervenir précocement, réduisant ainsi le risque de rechute et améliorant la qualité de vie des patients.
Parallèlement, avec des outils tels que Mon espace santé et les bilans de prévention, il devient envisageable de personnaliser les recommandations de prévention, en tenant compte de son historique médical, de son mode de vie et de ses préférences personnelles. Cette approche individualisée permet non seulement de mieux cibler les actions préventives, mais aussi d’impliquer activement les patients dans leur propre prise en charge de santé.
La prévention englobe aussi la promotion de modes de vie sains, la sensibilisation aux facteurs de risque, l’accès facilité aux dépistages et aux consultations préventives, ainsi que la coordination des acteurs de santé autour d’une vision commune de la prévention.
La prévention en santé ne peut donc se faire sans soutien. C’est dans ce contexte que les outils numériques peuvent jouer un rôle déterminant. Car, s’ils ne sont pas une fin en soi, ils ont en revanche le potentiel de transformer radicalement la pratique médicale telle que nous la connaissons. Les outils deviennent de plus en plus performants par l’amélioration de l’accès aux données et de leur exploitation. Les données ne sont enfin plus muettes !
Après avoir changé notre vie, en dématérialisant le papier et en modifiant nos relations, les outils numériques ouvrent aujourd’hui une nouvelle ère avec l’augmentation de la puissance de calcul informatique et la diminution du coût du stockage des données. Cette nouvelle ère, c’est celle de l’intelligence artificielle, générative ou non. Cette révolution technologique va modifier notre façon de penser, les rôles traditionnels et les dynamiques de travail. Elle ouvre de nouvelles perspectives dans la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement, la surveillance des patients.
Bien sûr, de façon générale, l’Intelligence artificielle peut faire peur. À chaque révolution technologique, une légitime question se pose : toutes ces avancées sont-elles vraiment des progrès ? Une menace ou un outil d’amélioration ? L’apocalypse ou une opportunité ?
Pour l’évaluation des dispositifs médicaux, à la Haute Autorité de santé, en présidant la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et technologies de santé (CNEDiMTS) j’ai été très souvent confrontée à la différence fondamentale à faire entre une nouveauté et une innovation. Tandis qu’une nouveauté peut n’avoir aucun intérêt, voire pire, le système de santé a besoin d’innovation. Parce que sans innovation, le système de santé recule et est sans avenir. Il s’agit donc de reconnaître les aspects positifs des mutations technologiques tout en restant critiques envers leurs impacts sur la société et l’environnement (améliorations dans la qualité de vie, la justice sociale, la durabilité environnementale, le bien-être humain…).
En somme, pour moi, le numérique et la prévention en santé sont deux faces d’une même médaille, appelées à se renforcer mutuellement pour relever les défis de santé du XXIe siècle. En investissant dans la prévention et en accompagnant les professionnels et les patients dans cette démarche, nous construisons un avenir où la santé est véritablement une priorité partagée, où la prévention est au cœur des pratiques cliniques, et où le numérique est un levier de progrès et d’efficience pour tous les acteurs du système de santé.
À nous de créer les conditions de la confiance, pour réussir la généralisation d’un usage éthique et efficient du numérique et de l’intelligence artificielle en santé.
J’en suis convaincue : un jour, ces deux faces permettront enfin de sortir du tout curatif et… le nom de l’Assurance maladie évoluera vers assurance santé !
- Protection sociale parrainé par MNH
- Relations sociales


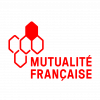


Afficher les commentaires
Le numérique et la santé/sécurité au travail
"Le numérique est perçu comme porteur de nouvelles menaces pour la santé et la sécurité au travail »....Cyril Cosme, Directeur du bureau pour la France de l’Organisation internationale du travail faiat part de ses réflexions ces dernières semaines au CRAPS également...
Une technologie n’est jamais bonne ou mauvaise en soi, tout dépend de son usage. C’est pourquoi on ne peut raisonner « toutes choses égales par ailleurs » lorsqu’on évalue son impact sur le travail. C’est l’ensemble des paramètres de l’organisation qu’il faut repenser : les compétences, les interactions au sein du collectif, le contenu des postes, la répartition des tâches, l’environnement de travail, le contrôle et le rapport à la hiérarchie.
Force est de reconnaître que le numérique est perçu comme porteur de nouvelles menaces pour la santé et la sécurité au travail, avant d’être considéré comme une ressource potentielle susceptible d’améliorer l’efficacité des politiques de prévention.
Cette focalisation sur les risques est compréhensible, mais elle biaise l’analyse dans la mesure où elle découle précisément d’un raisonnement « toutes choses égales par ailleurs ». Penser les nouvelles technologies numériques à organisation du travail inchangée, c’est en effet risquer de faire du travail humain une simple variable d’ajustement : substitution de la machine à l’homme à travers la suppression de postes de travail, adaptation de l’homme à la machine à travers des actions de formation technique. On passe ainsi à côté d’une opportunité de s’émanciper des grands principes tayloriens d’organisation (parcellisation, supervision, contrôle hiérarchique et reporting) grâce à un usage maîtrisé de ces technologies.
Pour bien faire, suivons le raisonnement d’un préventeur.
On distingue traditionnellement trois types de prévention. La prévention primaire agit sur les causes et les facteurs de risque, en les évitant. Pour les risques psychosociaux, les pratiques managériales harcelantes ou discriminatoires sont interdites. La prévention secondaire vise à atténuer l’exposition aux causes et facteurs de risque, lorsqu’on ne peut les éviter, grâce aux équipements de protection ou à des seuils réglementaires d’exposition. La prévention tertiaire consiste enfin à limiter au maximum les conséquences d’un dommage lorsqu’il est survenu.
S’agissant des technologies numériques, la logique de la prévention primaire nous inviterait donc à en déterminer un usage qui évite au maximum l’exposition aux risques nouveaux que ces technologies pourraient engendrer ou aux risques déjà identifiés qu’elles pourraient amplifier. En clair, il s’agit d’adapter la machine à l’homme et non l’inverse.
L’évolution de l’interface homme/machine constitue une bonne illustration de la complexité du lien entre numérique et prévention. Les robots vont devenir de plus en plus mobiles, embarquant une intelligence artificielle sans cesse plus performante, ouvrant de multiples possibilités de collaborer entre eux et avec les humains. Ces robots seront capables d’effectuer un grand nombre de tâches manuelles, mais aussi cognitives, que seuls des humains pouvaient jusqu’ici réaliser.
Ces nouvelles interfaces homme/machine sont à leur tour porteuses de risques liés à l’ergonomie, à la transformation et à la réduction des relations sociales au sein des collectifs de travail. À l’inverse, ces robots peuvent aussi soulager les travailleurs en allégeant leur charge de travail, en effectuant les tâches les plus pénibles et répétitives, et en les soustrayant à des situations dangereuses. Ils peuvent faciliter le maintien dans l’emploi de travailleurs âgés ou handicapés, encourager le travail humain à se concentrer sur l’innovation, la capacité d’analyse et l’intelligence émotionnelle et collective.
Un autre exemple montre l’ambivalence de l’impact des technologies numériques et la question décisive de l’usage. En même temps qu’il renforce potentiellement les moyens d’une organisation plus autonome et le « pouvoir d’agir » des travailleurs sur leur propre travail, le numérique ouvre un nouveau champ pour la surveillance, à travers des technologies de contrôle utilisant intelligence artificielle et algorithmes. Ces technologies permettent le développement de systèmes de gestion du travail collectant des données en temps réel sur le comportement des travailleurs qui déterminent des processus de décision automatisés ou semi-automatisés, élaborés par des algorithmes.
Ces systèmes dits algorithmiques servent une logique « taylorienne 2.0 » d’amélioration continue de la performance et de la productivité par la rationalisation de l’organisation de la production et l’optimisation des ressources humaines. Le risque de déshumanisation est tangible.
Les préoccupations que soulèvent de tels systèmes sont d’ordre éthique, réglementaire et concernent aussi la prévention des risques, en particulier psychosociaux. Pour ces raisons sans doute, la nouvelle réglementation européenne assimile l’IA utilisée pour la prise de décision affectant les relations de travail parmi les dispositifs à haut risque justifiant une transparence et un contrôle accrus des algorithmes.
À l’inverse, ces systèmes de gestion peuvent améliorer la prévention et servir une meilleure qualité du travail et des organisations plus autonomes s’ils sont conçus et mis en œuvre de manière transparente, avec une implication des travailleurs et de leurs représentants. La confiance est un facteur clef.
Les mêmes capteurs intelligents peuvent aussi permettre la collecte de données sur l’environnement de travail permettant d’alerter sur les situations dangereuses, l’exposition à des facteurs de risque ou encore de conseiller le travailleur. Elles peuvent contribuer à mieux évaluer les risques sur le lieu de travail, y compris les risques psychosociaux.
Dans cette perspective, le numérique renforce les moyens d’une politique de prévention pilotée par les données qui constitue une recommandation ancienne de l’OIT et un axe important de l’assistance technique fournie à nos membres en ce domaine. Mais là encore, le principe de responsabilité de l’employeur et les prérogatives des travailleurs et de leurs représentants doivent prévaloir. On ne peut s’en remettre entièrement ni se défausser sur un algorithme ou une technologie numérique. Ces outils orientent et guident des choix et des décisions qui relèvent in fine des acteurs du monde du travail. L’humain doit rester aux commandes, éclairé et non subordonné par l’IA.
Les impératifs de santé et de sécurité au travail méritent donc d’être pris en compte dès les phases de conception et de développement des technologies numériques. Ils doivent aussi conduire à revoir l’ensemble du processus de travail dans le cadre duquel ces technologies sont introduites, dans le cadre d’un dialogue entre les acteurs de la prévention et les développeurs de ces technologies, mais aussi dans le cadre d’un dialogue social effectif permettant l’appropriation de ces enjeux et la maîtrise de l’usage de ces technologies.
Faire du patient le véritable acteur de sa santé
Pour le Dr. Jean-Paul Ortiz, Président honoraire de la Confédération des syndicats médicaux français:« Les outils numériques doivent faire du patient le véritable acteur de sa santé » et « Il va falloir cultiver une démarche de prévention basée sur les outils numériques en imaginant des systèmes de récompenses »
La prévention en santé doit être une priorité du gouvernement. Il faut maintenant des actes. Développer la prévention est indispensable devant le vieillissement de la population et l’émergence des pathologies chroniques. D’autant plus que les résultats en termes de qualité de vie au-delà de 65 ans sont très décevants, inférieurs à nos voisins européens et plutôt en recul, alors que l’espérance de vie croît doucement. Vieillir plus, certes, mais bien, voilà le défi à relever !
Développer une vraie politique de prévention représente aussi un enjeu économique majeur puisque toutes les grandes études montrent combien les dépenses de santé seraient très largement contenues grâce à une ambitieuse politique de prévention. Malheureusement, ce bénéfice n’interviendra qu’au bout de quelques années, voire quelques dizaines d’années, ce qui est incompatible avec le temps du politique. Les choses peuvent-elles changer ? Oui, car l’arrivée du numérique en santé est une opportunité extraordinaire : son impact et son appropriation large sont extrêmement rapides.
Aujourd’hui, le numérique envahit nos vies quotidiennes à toute allure : les téléphones portables deviennent des outils permettant de contrôler le nombre de pas quotidiens, la distance parcourue, mais également la fréquence cardiaque, l’ECG, le sommeil, le stress, etc. Les montres connectées développent des contrôles permanents de paramètres vitaux sans que cela ne soit ni exploité, ni contrôlé, ni évalué.
Non seulement le numérique envahit la vie quotidienne de chacun, mais il bouleverse aussi l’exercice professionnel des professionnels de santé. L’heure n’est plus à discuter de l’informatisation du cabinet médical : ce temps est largement révolu. La télémédecine transforme l’exercice médical et le suivi du patient : la crise du Covid-19 a installé durablement la téléconsultation dans les outils d’accès aux soins, et la télésurveillance est devenue depuis quelques mois un élément de droit commun quittant la phase expérimentale et permettant le maintien à domicile de patients très fragiles sans risque pour leur santé.
Mais ce tsunami numérique se développe de façon anarchique, sans coordination, et certainement sans pouvoir retirer l’ensemble des bénéfices que la santé de nos concitoyens pourrait y trouver.
Pour le patient, l’équipement de son portable et de ses montres connectées est de l’ordre du gadget ou de l’argument commercial. Pour le professionnel de santé, il est perdu dans ses multiples outils et logiciels auxquels il n’avait pas été préparé, car il n’avait pas été formé pour leur utilisation optimale.
Comment peut-on faire du numérique en santé l’opportunité de mener une grande politique de prévention dans le pays ?
Tout d’abord, pour le citoyen, qui expose sa vie quotidienne sur les réseaux sociaux : faisons de cette impudeur l’occasion d’installer une prévention primaire personnalisée grâce à ces outils comme le podomètre ou la montre connectée. Développons les jeux, les objectifs, les comparaisons des efforts et des progrès obtenus dans le domaine de l’activité physique, de l’alimentation, des vaccinations et du dépistage…
Donner à chacun au quotidien, voire heure par heure, les résultats de ses efforts en termes d’activité physique doit pouvoir être largement utilisé, diffusé et être un stimulus pour une adhésion durable. De même, l’apparition des Nutri-Score sur les emballages de tous les aliments avec des applications analysant les achats de chacun sont autant d’éléments pour faire de ces outils des acteurs d’une vraie politique de prévention primaire. L’initiative privée doit se développer pour encore inventer de nouvelles applications axées sur les grandes priorités de santé publique que le pouvoir politique devra déterminer. D’ailleurs, pourquoi ne pas renforcer la politique vaccinale via une sollicitation personnalisée sur nos objets connectés au quotidien ?
Mais le côté ludique et vertueux ne suffira pas à entraîner tous nos concitoyens. Il va falloir cultiver une démarche de prévention basée sur les outils numériques en imaginant des systèmes de récompenses comme cela se fait avec beaucoup d’outils ou apps déjà existants dans d’autres domaines comme les jeux vidéo ou l’apprentissage des langues. Cultiver la valorisation de la bonne démarche sur sa santé, par exemple en valorisant le nombre de pas quotidiens, les bons d’achat alimentaires, etc., peut passer par une aide indirecte à maintenir cet effort. L’exemple de certains assureurs complémentaires proposant des bons de matériel de sport ou participant à l’abonnement pour une salle de sport pourrait être développé. Des avantages, y compris financiers, pourraient accompagner une démarche vertueuse de réalisation d’un programme de prévention personnalisée grâce aux outils numériques. Les assureurs complémentaires deviendraient alors de véritables acteurs d’une prévention à l’échelle de toute la population et trouveraient dans cette démarche une justification supplémentaire à leur maintien et à leur dynamisme.
Reste le problème des populations exclues, qui sont dans l’illectronisme, mais qui ne devront pas rester sur le bord du chemin. Il appartiendra alors à l’État de prendre des mesures spécifiques pour garantir une égalité d’accès à une politique globale de prévention à l’échelon de la population.
Mais il y a plus encore : obtenir l’adhésion à un traitement au long cours lorsqu’une pathologie chronique survient. Il s’agit d’un défi majeur : comment garantir le respect du plan de soins convenu entre le médecin et son patient ? Les outils numériques doivent faire du patient le véritable acteur de sa santé, et donc aller vers une véritable médecine participative. Les objets connectés permettent aujourd’hui la télésurveillance du patient. Mais cela est pour l’instant balbutiant. Demain, le respect de la prise médicamenteuse aux heures et aux doses prévues doit pouvoir s’assurer grâce aux outils numériques ; ils permettront l’alerte du médecin et la sensibilisation du patient si le traitement est oublié, voire suspendu. Dans le cadre des pathologies chroniques liées au vieillissement, cela deviendra essentiel pour garantir une meilleure qualité de vie aux seniors.
Il faut utiliser le tsunami numérique pour doter le professionnel de santé d’outils de prévention utilisés quotidiennement dans le cabinet médical. Certes, les logiciels professionnels ont permis des progrès considérables en la matière. Toutefois, il faut bien reconnaître que la France a beaucoup de retard par rapport à d’autres pays européens. Le taux de vaccinations, en particulier antigrippal, dans les populations à risque est dramatiquement en baisse : pour l’hiver 2023, à moins de 50 %, alors que l’objectif est à 75 %. L’échec cuisant de la vaccination contre l’HPV chez les adolescents témoigne bien des difficultés à obtenir dans le pays une large adhésion de la population à ces grandes campagnes préventives. On peut mener la même analyse et le même constat pour le dépistage du cancer du côlon et même du cancer du sein. Les logiciels métier du médecin doivent augmenter leur performance sur le contenu préventif. Chaque Français devrait avoir un carnet de vaccination dématérialisé et chaque médecin devrait avoir pour ses patients un rappel automatique des dates vaccinales et des différents dépistages pour chacun de ses patients. Cela est loin d’être le cas pour tous les logiciels métiers, et cela est loin d’être simple et ludique.
Si le patient utilise des applications lui permettant de suivre des programmes de prévention personnalisée, il est indispensable que des comptes rendus succincts puissent être communiqués au médecin, éventuellement via son DMP. Le DMP pourrait devenir le réservoir des éléments axés sur la prévention : carnet vaccinal, programme de prévention personnalisée, alarmes pour les rappels et contrôles préventifs, suivi pondéral et alimentaire, etc. Chaque professionnel de santé pourrait rappeler la nécessité vaccinale à chaque rencontre du patient avec le système de soins : médecin, pharmacien, infirmière, etc., et deviendrait ainsi un véritable acteur de prévention.
Faire du numérique l’opportunité d’une grande politique de prévention dans le pays nécessitera, au préalable, une stratégie clairement affichée autour de la prévention, stratégie définie par l’État qui devra mobiliser l’ensemble des acteurs concernés. Il faudra y intégrer les patients, les professionnels de santé, les organismes payeurs, en particulier les organismes complémentaires, les industriels du numérique en santé, en particulier les éditeurs de logiciels, mais plus largement tous ceux qui interviennent dans l’éducation à la santé, tels que l’école, le monde du travail, etc. Le choix courageux d’une grande politique préventive doit irriguer l’ensemble des secteurs dans le cadre d’une orientation « une seule santé » entraînant avec elle la santé animale et la santé environnementale. L’apport du numérique facilitera grandement cette démarche globalisée, qui aura un impact très favorable à moyen terme sur les comptes sociaux et ainsi permettra de garantir durablement l’équilibre de notre système de santé basé sur la solidarité et l’accès égalitaire pour tous.
Numérique et prévention
Le numérique devrait permettre une bien meilleure prévention et santé populationnelle
La multiplicité des acteurs, des sources de données et leur manque d’interopérabilité restent un frein majeur à l’exploitation que l’on pourrait en faire ».....Par Dr Charlotte Garret, Directrice médicale du Lab innovation santé de Santéclair
L’essor du numérique est en train de changer radicalement les paradigmes du système de santé. De nombreux avantages apparaissent à la lumière des nouvelles technologies et outre les freins liés à la fracture numérique, le digital pourrait permettre de penser la santé et la prévention différemment, plus efficacement.
Le numérique devrait permettre une bien meilleure prévention et santé populationnelle. L’analyse de données et l’intelligence artificielle permettent aujourd’hui d’affiner les risques individuels de développer une maladie. Le Mammorisk® en est un exemple : avec un questionnaire médical pour préciser les facteurs de risque, une mammographie et une analyse salivaire, fini les mammographies systématiques pour toutes les femmes de plus de 50 ans ! Le suivi sera modulé dès 40 ans en fonction du risque individuel. Il en va de même avec les risques cardio-vasculaires, le diabète, les cancers, la santé mentale…
Le numérique et l’analyse des données permettront aussi d’évaluer l’efficacité des mesures de prévention mises en place et de les adapter en fonction. Si on prend l’exemple de l’évaluation du risque cardio-vasculaire par une application santé, le suivi des données en vie réelle permettrait ensuite de valider cette évaluation du risque et si besoin de l’adapter. Les messages et les parcours qui permettent à l’individu d’aller au bout de son dépistage, de sa prise en charge préventive puis thérapeutique le cas échéant pourront également être évalués et ajustés. Avant d’atteindre cet idéal de prévention personnalisée permettant un dépistage précoce, un accompagnement adapté et un usage démocratisé, il reste de nombreux obstacles à franchir.
Le foisonnement des acteurs et l’interopérabilité des SI : les acteurs autour de la prévention en santé sont multiples et bien que les données soient de plus en plus nombreuses, l’interopérabilité des systèmes informatiques reste un frein majeur. Les données récupérées par l’Assurance maladie du SNDS sont une formidable source d’information, tout comme les données médicales des dossiers informatisés des patients dans les établissements de santé et chez les professionnels de santé mais aussi toutes les données récupérées par les applications santé. La multiplicité des acteurs, des sources de données et leur manque d’interopérabilité restent un frein majeur à l’exploitation que l’on pourrait en faire.
La protection des données personnelles : la réglementation européenne et encore plus particulièrement française est très stricte concernant la protection des données. C’est une véritable sécurité pour les individus et il faut garder des règles strictes sur leur utilisation. Cependant, la lourdeur des démarches et les délais incompressibles pour avoir accès aux données freinent leur exploitation. L’évaluation des solutions digitales : les difficultés sont nombreuses pour effectuer des travaux de recherche clinique et avoir une évaluation de leur efficacité. Les applications santé pullulent dans les champs de la prévention primaire, du bien-être, de la santé mentale et pourtant, il y a très peu d’études publiées sur leur efficacité, particulièrement en vie réelle. Nous manquons cruellement de données sur les tunnels de conversion, la rétention et les usages, mais surtout sur les impacts en termes de bénéfices pour l’individu et la société : impact sur la qualité de vie, impact sur la morbi-mortalité, impact médico-économique.
L’éthique : les innovations et l’intelligence artificielle ont ouvert de multiples questions éthiques. Si nous pouvons à l’avenir prédire les risques propres à chaque individu quels pourraient être les impacts psychologiques mais aussi sociétaux de savoir, par exemple, que nous avons un risque majeur de devenir dément à 60 ans ? La prédiction pour les maladies évitables où le dépistage et la prise en charge précoces peuvent changer le pronostic est plus facilement acceptable bien que cela n’écarte pas la question. Quid des maladies mortelles et pour lesquelles nous n’avons pas de traitement curatif ? Quels pourraient être les impacts sur les risques assurantiels, l’emploi, la prévoyance, la santé mentale… ?
Nous pouvons nous inspirer de ce qui fonctionne dans d’autres pays et développer des solutions concrètes afin de permettre de relever ces défis liés à la prévention et à l’accompagnement des individus grâce au digital. Le foisonnement des acteurs et l’interopérabilité des SI : favoriser le recensement des solutions digitales en santé sur Mon espace santé, et donner de la visibilité sur les évaluations faites de ces solutions. Généraliser l’interopérabilité des SI, des logiciels métiers des professionnels de santé mais également des applications/solutions digitales qui voudraient, par exemple, s’inscrire dans Mon espace santé.
La protection des données : Une étude récente menée par Ipsos pour Bristol Myers Squibb (BMS) France et l’EDHEC Business School montre que 42 % des Français sont inquiets pour leurs données de santé. Il faut rassurer les Français avec une meilleure transparence de l’usage qui est fait de leurs données tout en simplifiant l’accès aux données anonymisées.
Les difficultés à effectuer des travaux de recherche clinique et à avoir des données en vie réelle : afin de pouvoir mener plus d’études en vie réelle, on pourrait simplifier les démarches auprès de la CNIL et du CESREES et accélérer les accès surtout en cas d’anonymisation. Les entreprises et start-up en santé qui mettent à disposition des outils digitaux devraient avoir des obligations de publication de données en vie réelle, particulièrement quand elles relèvent du dispositif médical et d’un recensement sur Mon espace santé.
L’éthique : au-delà de suivre les multiples recommandations publiées par différentes organisations (OMS / ANS / CNPEN / DNS…) on pourrait envisager à l’instar de la CNIL un comité responsable de l’évaluation des considérations éthiques sur ces sujets de santé numériques dans lesquels l’IA va prendre une place prépondérante. Attention cependant à ce que cette autorisation éthique n’alourdisse pas le processus actuel et les délais déjà très longs.