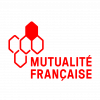La syndicalisation : des freins à lever !
Le faible taux de syndicalisation en France – environ 8 % dans le privé et 18 % dans le public – a de quoi étonner, surtout quand on se souvient d’un taux supérieur à 25% dans les années 1970, qui signifie qu’à l’époque, un salarié sur deux était syndiqué à un moment ou un autre de son existence.
Les explications les plus courantes à ce recul exceptionnel qu’a connu la France, comparée aux autres pays développés, à savoir le repli individualiste ou encore l’atomisation du monde du travail, loin d’être satisfaisantes, cachent d’autres réalités et beaucoup de fausses représentations.
Elles font aussi oublier qu’à y regarder de plus près, il y a de quoi croire à la force de la syndicalisation, pour laquelle notre organisation se mobilise au quotidien. Dans le contexte actuel, nous avons tenu à en faire un dossier spécial de rentrée.
Une longue histoire
Synonyme de nouvelles libertés publiques dans la sphère privée et politique, la Révolution Française a réduit les libertés des travailleuses et travailleurs et a, ce faisant, posé les bases de la discrimination syndicale.
La place prépondérante des professions libérales parmi les députés du tiers état a eu tôt fait d’aboutir, en 1791, à l’adoption de la loi « Le Chapelier ».
Cette dernière met fin au système des corporations qui organisait le travail depuis le moyen-âge, avec des règles de métiers, d’apprentissage, de concurrence… et interdit au passage tout groupement professionnel, tout syndicat naissant et le droit de grève.
Elle est votée en réaction aux revendications salariales qui s’étendent dans tout le pays parmi le groupe montant des ouvriers et des petits artisans, qui développent au passage des sociétés de secours qui sont les ancêtres des mutuelles et de la sécurité sociale. Isaac Le Chapelier l’a lui-même expliqué devant la toute jeune Assemblée nationale : « Il doit sans doute être permis à tous les citoyens de s’assembler ; mais il ne doit pas être permis aux citoyens de certaines professions de s’assembler pour leurs prétendus intérêts communs ; il n’y a plus de corporation dans l’État ; il n’y a plus que l’intérêt particulier de chaque individu, et l’intérêt général. Il n’est permis à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation. […] Il faut donc remonter au principe que c’est aux conventions libres d’individu à individu à fixer la journée pour chaque ouvrier. »
Plus clairement, il est fondamentalement intolérable de chercher à se rassembler entre semblables pour obtenir un rapport de force.
C’est au nom de cette idéologie que les corporations sont interdites, puis les syndicats. Il faudra attendre presque un siècle pour qu’ils soient à nouveau autorisés, en 1884. La bataille pour la reconnaissance de la discrimination syndicale à l’usine Peugeot de Sochaux dans les années 1990 constituera un tournant. Ce qui fut une épopée judiciaire, symbolique par l’ampleur du système discriminatoire mis en évidence et par la méthode que le tribunal a validée dans l’administration de la preuve (voir article p.8), sera suivie de bien d’autres.
Depuis, la lutte contre les discriminations s’est diversifiée (handicap, sexe, race, etc.) à mesure que se révélaient de nouveaux champs, tous combattus par le syndicalisme, qui n’est que l’un d’entre eux.
Les mouvements sociaux du début 2023 autour de la loi réforme des retraites ont rappelé la place centrale occupée par les syndicats en France.
Le rôle qu’ils jouent dans le débat public, comme dans la vie des entreprises, n’a pourtant rien d’une évidence. La liberté syndicale et le droit de grève ont beau être garantis par la Constitution de la Vème République, l’engagement syndical ne va pas toujours de soi.
Le phénomène peut paraître d’autant plus intriguant qu’à en chercher les causes, on trouve surtout de quoi attendre une tendance inverse. Ainsi, comme le montre la dernière étude du CEVIPOF, son fameux « baromètre de la confiance politique » paru en février 2024, plus de 40 % des personnes interrogées font confiance aux organisations syndicales, loin devant les partis politiques et les institutions. Seuls 3 % des salariés s’en défient complètement.
Une autre étude, réalisée fin 2023 pour le compte de l’association Réalités du dialogue social (avec la participation de plusieurs organisations syndicales, dont FO, ainsi que du MEDEF) montre même que dans la catégorie de population la moins syndiquée – les jeunes, qui sont aussi un enjeu pour le renouvellement des rangs militants –, on est très loin de l’allergie au syndicalisme. Ainsi, 72 % des jeunes interrogés sont d'accord avec l’affirmation « on a besoin de syndicats dans les entreprises quelles qu'elles soient ». Ils sont même 76 % entre 25 et 29 ans.
Si près de la moitié estiment que « dans une entreprise où les salariés peuvent régler leurs problèmes professionnels directement avec leur manager, on n'a pas besoin de syndicats », ils sont presque autant à juger les relations entre les employeurs et les salariés « compliquées » et 27 % « conflictuelles » tandis que moins d'un sur cinq les qualifie de « constructives », « saines » ou « fluides ».
Beaucoup croient également à l'efficacité de l'action syndicale : les trois-quarts jugent que « quand on est représentant des salariés dans une organisation syndicale ou patronale, on a la possibilité de faire bouger les choses » et 72 % expriment leur confiance dans l'efficacité de la participation à un mouvement collectif.
Mieux encore, alors que la montée en compétences a pour effet un accroissement du nombre des cadres et techniciens dans les jeunes générations, près de deux jeunes sur trois jugent que « les syndicats représentent tous les travailleurs ». L’enjeu du renouvellement est d’autant plus fort que c'est dans les classes d'âge des moins de 40 ans que le taux de syndicalisation est le plus faible : en 2019, selon les statistiques du ministère du Travail, il plafonnait à 8,1 % chez les trentenaires et frisait le plancher avec à peine 2,7 % chez les moins de 30 ans, contre une moyenne de 10,3 % dans l’ensemble de la population active. Ce n’est pas un secret, le rajeunissement des troupes est un enjeu majeur pour les syndicats. Et plus on rejoint une organisation syndicale jeune, plus longtemps on reste adhérent et souvent militant. L’intérêt que nous portons à la jeune génération est réciproque, mais reste à créer les conditions de la rencontre. D’autant que les motivations qui peuvent amener à s’engager syndicalement existent bel et bien.
Par exemple, 39 % des jeunes interrogés y voient le moyen de « contribuer à améliorer les conditions de travail [des] collègues ». Ils sont 37 % à considérer que c’est un moyen d'être « mieux informé sur [ses] droits en tant que salarié ou agent », et près d'un tiers avance comme élément de motivation le sentiment de « se sentir utile ».
A cela s’ajoute que 70 % des 35 ans et moins affirment avoir « la volonté de s'engager pour une cause ». L’intérêt purement personnel que peut représenter le statut de salarié protégé arrive en queue de liste, cité que par 18 % des jeunes interrogés. Nous avons en partage des valeurs et des objectifs, mais il faut bien reconnaître que des obstacles se dressent sur le chemin qui devrait nous permettre de converger.
Des raisons structurelles
Si les raisons de s’engager syndicalement ne manquent pas, on peut avancer quelques raisons qui freinent la syndicalisation. La progression des contrats à durée limitée dans certains secteurs y contribue. Les transformations structurelles de l’emploi jouent aussi. La désindustrialisation a affaibli les bastions syndicaux. La persistance d’un chômage de masse et de la précarité du travail a rendu encore plus difficile l’adhésion à un syndicat.
Selon le ministère du Travail, seuls 2,3 % des salariés en CDD ou en intérim sont syndiqués contre 11,8 % des salariés en CDI. Se pose aussi le problème du syndicalisme « par procuration » : pas besoin d’adhérer pour profiter de ce que négocie le syndicat, qui bénéficie à tous les salariés. Aussi étonnant et simple que cela puisse paraître, près d’un jeune sur cinq affirme ne pas connaître les organisations syndicales et ne même pas savoir « à qui s’adresser ».
Selon une autre étude, émanant de la DARES (le bureau des statistiques du ministère du Travail) en 2017, plus d’un salarié non syndiqué sur quatre attribue sa non-adhésion à l’absence de syndicats sur les lieux de travail (sachant que les deux-tiers de la population vivent dans des déserts syndicaux), quand la moitié des syndiqués expliquent avoir adhéré suite à la démarche d’un représentant syndical ou d’un collègue syndiqué.
Dans Anatomie du syndicalisme, paru en 2021, Dominique Andolfatto et Dominique Labbé, spécialistes en science politique, ont pointé une certaine désertion du terrain comme facteur explicatif à la baisse de la syndicalisation.
Si les nombreuses évolutions, ou plutôt devrait-on dire régressions, législatives depuis la loi sur la représentativité de 2008 ont transformé les syndicalistes en « professionnels de la représentation » peu visibles en dehors des périodes électorales, un autre phénomène serait selon eux à l’œuvre. Au-delà de leur « accaparement par des tâches institutionnelles et, notamment, la négociation, qui a distendu les liens avec les personnels », les syndicalistes auraient trop souvent tendance à délaisser les tâches les plus ingrates, comme celle de quadriller le terrain « au profit d’autres activités plus gratifiantes comme les réunions avec la direction, la gestion du CE, la négociation ».
La proximité des représentants syndicaux avec les salariés, ainsi que la visibilité de leurs organisations et activités sur les lieux de travail, ou encore les relations personnelles et les affinités existant avec des collègues déjà syndiqués sont des facteurs d’adhésion syndicale et de participation des salariés, et constituent autant d’axes de progression pour notre organisation autour d’une réalité : difficile de contacter notre organisation là où elle n’est pas implantée.
Il a y a cependant une explication moins souvent mise en avant quant à la faiblesse du taux de syndicalisation dans notre pays : la peur des représailles.
Le rapport du Défenseur des Droits sur la discrimination syndicale paru en 2019 n’a ici pas perdu de son actualité.
En l’occurrence, il tend à montrer qu’entre un salarié syndiqué et son collègue qui ne l’est pas, il existerait trop souvent une différence de traitement qui s’apparente bel et bien à de la discrimination. Le droit et l’économie en proposent une définition assez similaire, la considérant avant tout comme la violation d’un principe : principe d’équité pour l’économie – “à productivité égale, salaire égal” – ; principe d’égalité en droit – “à travail égal, salaire égal” –. Le Défenseur des droits estime que « pour la population active comme pour les personnes syndiquées, la peur des représailles est la première cause explicative du non-investissement des salariés dans l’activité syndicale » puisque, d’après son enquête, près de la moitié (46%) des personnes syndiquées estiment avoir déjà été discriminées au cours de leur carrière professionnelle en raison de leur activité syndicale.
Pour 51% d’entre elles, leur activité syndicale aurait représenté un frein à leur évolution professionnelle. Plus de quatre personnes syndiquées sur dix (43%) estiment que les relations avec leur hiérarchie se sont dégradées en raison de leur activité syndicale, 36 % considèrent que leurs conditions de travail en ont pâti et presque autant jugent que cela a été la cause d’un refus d’augmentation salariale.
Cette tendance est plus marquée dans le secteur privé que dans le public, ce qui peut expliquer les différences de taux de syndicalisation entre les deux secteurs, avec une sécurité de l’emploi qui, bien qu’en recul, reste plus forte dans le premier que dans le deuxième.
L’enquête montre aussi que ce sentiment est plus marqué au sortir d’une grève ou lorsque le climat social peut être qualifié de tendu.
L’étude sur la syndicalisation de la DARES publiée en février 2023 va dans le même sens.
S’agissant de déclarations de représentants du personnel, il est difficile de démêler ce qui tient de la perception – la prise de conscience d’inégalités vécues peut être favorisée par différents facteurs dont une institutionnalisation des relations sociales dans l’établissement – et de la réalité objective. On touche ici à un point essentiel de cette problématique : les perceptions et impressions pèsent bien plus lourd que les seuls faits. « Il ne faut pas se laisser intimider par les statistiques.
Nous devons tordre le cou aux idées reçues et mieux montrer aux salariés qu’ils ont besoin d’organisations syndicales fortes, et que pour cela il faut les rejoindre car les salariés ont besoin d’être défendus et ne le seront jamais aussi bien que par eux-mêmes.
Notre pratique d’un haut niveau de dialogue social a également des vertus dont profitent les entreprises où nous le portons. En donnant la primauté à la négociation sur le bras de fer et la crise, nous contribuons à créer et maintenir un climat social apaisé indispensable à leur bonne marche économique. Reste que pour le Défenseur des droits, le fait d'avoir participé à une grève, distribué des tracts, été inscrit sur une liste aux élections professionnelles, effectué un stage de formation syndicale, participé à une négociation, détenu un mandat, bref, d’avoir accompli ses missions syndicales, accroîtrait significativement la probabilité de déclarer une discrimination.
Le syndicalisme demeure, pour les directions d’entreprise, le danger numéro 1.
Car le 20ème siècle a prouvé que si un partage de la richesse produite pouvait advenir, c’était d’abord du fait de leur action, avant même celle des partis politiques
Une réalité difficile à mesurer
Le faible volume de contentieux en matière de discrimination syndicale – 660 décisions par an au niveau des prud’hommes, rapportées aux près de 767 000 représentants élus ou désignés – invite à se poser la question de la véritable étendue de ces pratiques qui, par ailleurs, trouvent aussi une solution dans le recours à l’inspection du travail, au Défenseur des droits, ou tout simplement par la négociation avec les directions d’entreprises.
A noter également que sur l’ensemble des réclamations qu’elle reçoit, la HALDE n’en classe que 4 800 dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 5,6 % d’entre elles (soit quelques centaines) concernent l’activité syndicale, qui n’est que le cinquième motif de réclamation, derrière l’origine, le handicap, l’état de santé et l’âge.
L’écart entre l’étendue des opinions et attitudes potentiellement discriminatoires (notamment anti-syndicales) et les pratiques qui peuvent être dénoncées juridiquement ou, du moins, faire l’objet d’une réclamation officielle , impose d’ailleurs une nuance, puisque l’utilisation de la notion de discrimination n’est pas neutre : l’existence de méthodes standardisées de preuve associées à la notion en facilite la mise en évidence, par le droit comme par les sciences sociales ; mais dans le même temps, elle en restreint la portée, puisque seules certaines situations peuvent être qualifiées de discriminatoires.
Les pratiques antisyndicales mises à jour sont le plus souvent cachées ou discrètes, illégales ou illicites.
La discrimination n’en est qu’une, qui s’inscrit donc dans une idée plus large d’anti syndicalisme. Ainsi, des techniques managériales de contournement et de domestication des syndicats aux usages du droit et des juristes par les directions d’entreprise, en passant par les stratégies pour soutenir un syndicalisme de cogestion quand ce ne sont pas de véritables “syndicats maisons”, la palette de l’anti syndicalisme ne manque pas de couleurs.
La stratégie d’affaiblissement du contre-pouvoir syndical mise en évidence utilise à la fois des méthodes directes (discrimination salariale et blocage des carrières ; contrôle de l’embauche ; mobilisation de l’encadrement et de la maîtrise) et plus indirectes (utilisation des possibilités réglementaires pour freiner le « dialogue social », division syndicale, etc.
Ces pratiques n’ont pas disparu partout, et étaient même encore enseignées dans les années 2000 dans le cadre de stages de formation lors desquels des cadres d’entreprise, des directeurs des ressources humaines et des managers, apprenaient à désarmer l’action collective des salariés. Au-delà de ces situations, la question de la discrimination ne saurait donc se ranger dans la seule catégorie caractérisée par le droit, de simples exemples le montrent.
Ainsi, jouer sur les seuils sociaux pour éviter d’avoir des représentants du personnel dans son établissement doit-il être rangé du côté de la discrimination syndicale ?
Favoriser une organisation syndicale plutôt qu’une autre, ou même des représentants non syndiqués, constitue-t-il une entrave à l’exercice du droit syndical ou un mode acceptable de régulation des relations sociales dans l’entreprise ?
Là encore, l’ignorance est à la base de bien des tracas, puisque la DARES a montré que les dirigeants sont d’autant plus critiques à l’égard des représentants du personnel, et tout particulièrement des syndicats, que ces derniers ne sont pas présents dans l’entreprise.
« Partout où nous sommes implantés,nous avons démontré les bienfaits du dialogue social. Le développement syndical et la syndicalisation incarnent davantage la solution que le problème. » Enfin, il ne faut pas oublier le réformisme de FO, dont l’efficacité n’est plus à démontrer.
Notre organisation n’as pas attendu que la classe politique soit l’objet d’une défiance généralisée dans notre pays pour prouver qu’elle n’est alignée sur aucun parti, une position qui remonte à 1906 et à la Charte d’Amiens ! Elle a surtout obtenu des résultats par des pratiques du quotidien : écouter autant que se faire entendre, proposer autant que contester, mais aussi tendre la main plutôt que serrer le poing pour parvenir à des solutions gagnant-gagnant.
Comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, chaque nouvel accord de salaire représente une petite évolution, mais mises bout à bout, elles constituent une augmentation plus que notable sur la fiche de paie, dont notre organisation est ainsi devenue la championne. Notre efficacité et celle de notre réformisme, vecteurs de progrès social, ne sont pas celles du tapage permanent, mais le fruit de la persévérance et du pragmatisme appliqués avec méthode et conviction.
A lire aussi dans notre dossier
- Des droits pour protéger le syndicalisme
La notion de discrimination ne s’est stabilisée qu’il y a une vingtaine d’années en droit et ne se limite pas au syndicalisme. En France, la protection juridique de l’activité syndicale est bien antérieure à la construction du droit des discriminations. Constituant un arsenal bien fourni, ce dernier n’en reste pas moins exigeant et parfois difficile à faire appliquer
- La syndicalisation plein cadre