L’accès aux soins : mythe ou réalité à l’aube des 80 ans de la Sécurité sociale
La branche maladie de la Sécurité sociale a entre autres pour mission la prise en charge des dépenses médicales et paramédicales engendrées par les soins. Cette prise en charge prend la forme soit de remboursements, soit de versements d’indemnités journalières en vue de compenser la perte de revenus subie par l’assuré du fait de sa maladie.
De ce fait, l’essence même du système de l’assurance maladie en France est de soigner en fonction des besoins, indépendamment des ressources et des moyens dont chacun dispose.
Notre système de santé a été, à l’origine, fondé sur le principe de solidarité. Un héritage de notre combat, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, inscrit au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui dispose :
La Nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé.
Au fil du temps et du développement des systèmes d’assurance maladie obligatoires, cette garantie constitutionnelle s’est étendue à toute la population, sans distinction d’âge, d’état de santé, de niveau de revenus, d’éducation ou de résidence. C’est le sens même de la Protection universelle maladie (PUMA), instaurée en 2016 et permettant à toute personne résidant en France de manière stable et régulière de bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé.
Notre solidarité va encore plus loin en assurant que toute personne malade – peu importe son origine, sa situation administrative, sa nationalité, son âge –sur le territoire français a le droit d’être soignée.
L’accès aux soins est avant tout un enjeu de santé publique puisque l’accessibilité aux soins suppose que tout le monde se soigne mieux, ce qui s’inscrit d’ailleurs dans une démarche de prévention. C’est aussi un enjeu d’équité, parce qu’il est essentiel de tout mettre en œuvre pour qu’indépendamment de son revenu ou de sa situation géographique, tout le monde puisse bénéficier d’une prise en charge de qualité.
C’est donc logiquement que l’accès aux soins constitue depuis longtemps la première des missions de l’Assurance maladie et de son réseau.
Mais qu’en est-il aujourd’hui, quatre-vingts ans après ?
Un manque de professionnels de santé
Le constat est alarmant : 87 % du pays est un désert médical avec 6 millions de Français qui n’ont pas de médecin traitant. L’accès aux soins suppose aujourd’hui d’avoir les moyens financiers de payer des dépassements d’honoraires, par exemple dans des territoires devenus des déserts médicaux pour certaines spécialités, en plus des généralistes. Ainsi, 40 % des personnes renoncent à se soigner pour des raisons financières, alors que le droit à la santé, garanti par l’État, doit permettre à toute personne malade de se faire soigner, indépendamment de sa situation financière.
L’attaque permanente et incessante des droits des assurés sociaux
Ces dernières décennies ont été marquées par des diminutions des droits des assurés sociaux dont les dernières en date sont :
- la hausse du ticket modérateur de 30 % à 40 % ;
- le doublement des franchises médicales et de la participation forfaitaire ;
- la baisse du plafond des indemnités journalières de 1,8 Smic à 1,4 Smic.
Ce qui a pour conséquence le renoncement aux soins et un transfert de charges vers les organismes complémentaires.
Quatre-vingts ans après, l’accès aux soins des Français est devenu l’un des défis majeurs de l’Assurance maladie avec des conséquences lourdes pour la santé des Français.
- Protection sociale parrainé par MNH
- Relations sociales


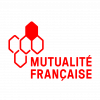


Afficher les commentaires
Pour une branche recouvrement au service de la justice sociale
"De chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins", cette maxime fonde, depuis les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, notre système de sécurité sociale.
Elle repose sur un principe central : les cotisations sociales prélevées sur les revenus d’activité assurent, depuis près de quatre-vingts ans, un système de solidarité et d’équité contributive entre les entreprises et les personnes protégées.
Pour organiser cette collecte, le décret du 12 mai 1960 crée les URSSAF [1]. Par la suite, l’ordonnance du 21 août 1967 institue une branche autonome : la branche recouvrement, confiée à l’ACOSS [2], chargée de la trésorerie de l’ensemble des caisses de Sécurité sociale.
Les URSSAF ont pour mission de contrôler, collecter et redistribuer les cotisations et contributions sociales finançant près de 880 organismes dans le domaine de la maladie, la retraite, la famille, les accidents du travail, etc. Depuis, leur rôle n’a cessé de croître, jusqu’à devenir un rouage essentiel de la solidarité nationale. En 2024, 571 milliards d’euros ont été encaissés par le réseau auprès de 11,8 millions de cotisants, ce qui en fait le cœur battant du financement de notre protection sociale.
Pourtant ce réseau est soumis à une pression croissante au nom de la performance et de la rationalisation : régionalisation [3], mutualisations, suppressions de postes, missions accrues… Ces transformations nuisent à la qualité du service rendu comme aux conditions de travail des agents.
Parallèlement, la nature même des missions des URSSAF est altérée par une évolution inquiétante du financement de la Sécurité sociale. La part des cotisations diminue (48 % des recettes en 2023) [4] en raison de la multiplication des mesures d’exonération (77,3 milliards d’euros en 2024) [5] et du poids de la fraude aux cotisations, estimée entre 6 et 7,8 milliards d’euros (jusqu’à 10,2 milliards d’euros en incluant les erreurs de déclaration) [6]. Cette baisse de recette est directement supportée par l’ACOSS, ce qui contrevient à la mission de l’agence, qui n’a pas « vocation à s’endetter » [7].
À l’approche des 80 ans de la Sécurité sociale, FO rappelle qu’il est urgent de revenir aux fondements de notre système de protection sociale. Cela passe par le rétablissement d’une équité contributive entre les entreprises et les assurés, indispensable au maintien d’un haut niveau de garantie couvert.
Ainsi, FO revendique un renforcement des moyens humains et matériels de la branche pour permettre aux URSSAF de remplir pleinement leurs missions, notamment dans la lutte contre la fraude.
FO revendique également la suppression progressive des allégements de cotisations, afin de rétablir un modèle social juste, équitable et solidaire.
Notes
[1] Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales.
[2] Agence centrale des organismes de Sécurité sociale, devenue URSSAF Caisse nationale en 2021.
[3] La COG État-ACOSS 2010/2013 est venue changer le maillage territorial des URSSAF : vingt-deux URSSAF régionales remplacent les cent cinq départementales qui existaient auparavant.
[4] Rapport de la commission des comptes de la Sécurité sociale – octobre 2024.
[5] Annexe 4 – LFSS pour 2025.
[6] Observatoire de l’impact du travail dissimulé sur les finances sociales, réunion du 5 décembre 2024, HCFIPS : faisant des entreprises les premiers fraudeurs sociaux, bien loin devant les assurés sociaux (montant estimé à 4,4 milliards d’euros ).
[7] Rapport de la Cour des comptes sur l’application des lois de financement de la Sécurité sociale – 26 mai 2025.
IL N'EST JAMAIS TROP TARD POUR BIEN FAIRE
PROTECTION SOCIALE : IL N'EST JAMAIS TROP TARD POUR BIEN FAIRE
Les discours politiques se succèdent pour vanter les mérites de notre système de protection sociale, tout en décrivant une réalité budgétaire alarmiste. Et pourtant, les salariés du privé en particulier continuent de porter à bout de bras un édifice que l’on fragilise à coups d’exonérations, de niches et de décisions technocratiques.
Une infographie récente, commandée par le SNFOCOS, met en lumière une vérité trop souvent éclipsée : 40 % des prélèvements obligatoires d’un salarié du privé sont constitués de cotisations sociales. À cela s’ajoutent 25 % de cotisations affectées à la solidarité nationale, 20 % d’impôts directs et 15 % d’impôts indirects. Autrement dit, les deux tiers des efforts contributifs des salariés servent à financer la protection sociale.
Et pourtant, ce financement est en péril.
Pourquoi ? Parce que les exonérations de cotisations patronales se multiplient sans évaluation sérieuse de leur efficacité. Parce que les nouvelles formes d’emploi échappent encore trop souvent à la solidarité contributive. Parce que les revenus du capital restent largement épargnés par l’effort collectif.
Il est temps d’ouvrir le débat sur le partage de l’effort collectif, de redonner du sens à la solidarité, et de défendre, avec force, une protection sociale universelle, juste et durable.
Branche famille de la Sécu : un investissement pour l'avenir
La branche famille de la Sécurité sociale est issue d’un long processus historique. Dès 1918, des industriels créent des caisses de compensation, ancêtres des CAF, afin de verser des compléments familiaux aux travailleurs ayant la charge d’une famille. Ces sursalaires se développent dans toute la France, dans un double objectif : fidéliser les salariés et contenir les revendications salariales.
En 1932, la loi Landry généralise le principe de sursalaires familiaux pour tous les salariés de l’industrie et du commerce ayant au moins deux enfants. L’adhésion des employeurs à une caisse de compensation devient obligatoire. On assiste alors à la première généralisation des allocations familiales.
Plusieurs décrets-lois [1]. Sont notamment financés : les allocations familiales, les crèches, les centres sociaux, les aides au logement, le soutien à la parentalité.
Ses missions ? Aider les familles dans leur vie quotidienne en facilitant l’articulation vie familiale et professionnelle ; améliorer le cadre de vie des allocataires et développer la solidarité envers les plus vulnérables.
Pourtant depuis plus de trente ans, la branche ne cesse d’être fragilisée : baisse et remplacement des cotisations par des recettes fiscales [2], fin du principe d’universalité des prestations [3].
L’effet de ces politiques, rompant avec les fondamentaux issus du Conseil national de la Résistance, c’est un taux de natalité en berne avec 1,68 enfant par femme en 2023, un record depuis la Seconde Guerre mondiale.
C’est par son positionnement constant de défense des familles et des allocataires que FO est la première organisation syndicale en matière de présidence des CAF. Afin de retrouver une branche qui joue pleinement son rôle, FO revendique :
Pour FO, la branche famille n’est pas une charge mais un investissement d’avenir !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notes
[1] Du 12 novembre 1938 et du 29 juillet 1939.] viendront par la suite poser les bases de la branche famille, notamment en posant le principe d’allocation progressive (dissociée du salaire) selon la taille de la famille et versée quel que soit le revenu avec un taux uniforme (principe d’universalité des prestations).
En 1945, l’ordonnance fondatrice de la Sécurité sociale reconnaît un droit universel à garantir les charges de famille. Les CAF sont ainsi créées, mettant fin au monopole patronal pour la gestion des caisses.
Aujourd’hui, cette branche concerne 33,1 millions d’allocataires, 95,5 milliards d’euros de prestations [[La politique familiale mobilise entre 2,7% et 4,7% du PIB, soit l’un des taux les plus importants au monde.
[2] Entre 2014 et 2022, diminution de 15,4% des recettes nettes de la branche famille, venant affaiblir son autonomie financière.
[3] Abrogé par la LFSS pour 2015.
Bienvenue dans le monde du travail
Bienvenue dans le monde du travail : Sauvegarder notre protection sociale collective
Producteur : Force Ouvrière http://www.force-ouvriere.fr Conception, réalisation : Pierre Wolf/SFJ Direction artistique, illustrations et animation 2D : Julie Huguen, studiotricot.com Mixage : Christian Cartier